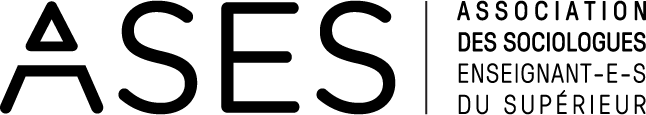Hommages à Pierre Tripier (1934-2025)

Hommage de l'ASES à l'un de ses co-fondateurs (en 1989)
Comme il le disait lui-même, Pierre Tripier est venu à la sociologie tardivement. Après de premières brèves études, il est appelé au service militaire en Algérie pour 27 mois qui le changeront à jamais. A son retour, il commence à travailler dans une imprimerie.
Un accident du travail dans l'imprimerie l'a amené à y faire des statistiques et l'a encouragé à reprendre des études supérieures. Il s’inscrit en Sorbonne Lettres, où il commence une licence de sociologie qui venait d’être créée. A 30 ans, ayant obtenu sa Licence, il participe, sur proposition d’Alain Touraine, à une recherche menée sur les contremaîtres aux Usines Renault, commençant dès lors une fructueuse spécialisation en sociologie du travail dont il deviendra l’un de piliers et des plus fins analystes.
En 1967, il est nommé assistant à l’Université de Nanterre, tout juste créée. Il y vit les évènements de Mai 68 et a pour étudiant notamment Daniel Cohn Bendit. Il reste à l’Université de Nanterre jusqu’à la soutenance de sa thèse d’Etat. Après un passage à l’Université de Besançon, où il occupe son premier poste de professeur de sociologie, il revient à l’Université de Nanterre. Il y est directeur du département de sociologie et chercheur au laboratoire Travail et Mobilités.
Cependant, en 1991, la naissance de l’Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, à partir, entre autres, d’un des centres délocalisés de l’Université de Nanterre, lui ouvre de nouvelles perspectives. Il part y co-créér une formation et un département de sociologie et, en 1995, un tout nouveau laboratoire de sociologie du travail : le laboratoire Printemps (Professions, Institutions, Temporalités). Celui-ci, devenu UMR en 1998 (UMR 8085), s’impose rapidement comme une unité de recherche réputée en sociologie des groupes professionnels, comme pour ses analyses des institutions et méthodes d’analyse des trajectoires sociales. Profondément engagé dans des réflexions pratiques sur le métier d’enseignant-chercheur en sociologie, Pierre Tripier fonde, en 1989, l’Association des sociologues de l’enseignement supérieur, pour défendre, améliorer et promouvoir l’enseignement de la sociologie, notamment sur le plan politique, face au ministère. Il en assure la première co-présidence.
Pierre Tripier, qui avait connu la sociologie du travail en train de se créer, en proposait une analyse très fine de ses paradigmes et de leurs évolutions . Il a lui-même participé à une sociologie des cadres, à travers une analyse de leur espace de qualification. Ses travaux ont contribué à l’analyse du travail par une prise en compte des contextes de qualification, d’emploi et de trajectoires. Son ample connaissance des travaux de sociologie du travail, couplée à une très grande érudition sur la sociologie interactionniste et à une grande curiosité pour les travaux historiques, l’avait amené à publier, avec Claude Dubar, le premier manuel de sociologie des professions en France, en 1998 , réédité trois fois. Il avait développé un intérêt majeur pour les questions de genre en sociologie du travail , ce qui l’a amené à rentrer au comité de rédaction de la revue « Les Cahiers du genre ».
Féministe dans ses travaux, il l’était aussi dans la vie professionnelle ordinaire, encourageant, et soutenant les femmes, attaquant ceux qui les attaquaient. Très vigilant face aux rapports de pouvoir et d’autorité, il était meToo avant l’heure, se risque-t-on à dire, se comportant avec les étudiantes ou les collègues femmes avec respect et droiture. Car Pierre Tripier ne séparait jamais la théorie de l’action. Ce qu’il professait, il l’appliquait. C’est ainsi en sociologue du travail et des professions, avec une grande réflexivité, qu’il analysait son propre milieu professionnel et y agissait. Il regardait d’un air amusé et ironique, celles et ceux qui étaient des cordonniers mal chaussés.
De son côté, il mettait à profit son goût pour les travaux de sciences sociales sur la guerre et l’armée, et surtout sa lecture de Clausewitz, pour naviguer et agir en milieu universitaire. Un milieu dont, à l’écouter raconter ses anecdotes des années 70 aux années 90, ne devait en effet pas être loin d’un champ de bataille. Un milieu hostile qu’il n’a eu de cesse, avec tous ses complices et notamment Maryse Tripier, son épouse et compagne de vie pendant près de 60 ans, de chercher à apaiser et à rendre vivable pour les générations suivantes.
La sociologie était pour Pierre Tripier une science appliquée, au sens où elle devait permettre de penser l’action et d’agir sur le monde. C’est ce qui l’a amené entre autres à conduire des recherches pour aider à résoudre des problèmes de qualité dans les organisations et à participer à l’Institut de Recherches et de Développement de la Qualité. Mais loin d’en rester à ce niveau de l’action, c’est bien le retour vers la théorisation qui l’intéressait. C’est ainsi qu’il a entraîné une petite équipe dans un travail de recherche, ayant débouché sur un ouvrage décryptant les processus d’aveuglement organisationnel à l’origine de dysfonctionnements répétés . Son goût pour la théorie se retrouve bien évidemment dans l’ouvrage Sociologie des professions, co-écrit avec Claude Dubar, mais également dans celui co-écrit avec Bruno Pecquignot , sur les fondements de la sociologie. Dans ce dernier, s’appuyant sur une vaste érudition dans les sciences physiques, biologiques et historiques, les auteurs soulignent les apports des modèles de ces sciences à la constitution de la sociologie.
Enfin, Pierre Tripier était un grand lecteur, ouvert et curieux. Il rapportait de ses voyages littéraires ou scientifiques hors de la sociologie, des modèles et concepts, qu’il mettait à l’épreuve de notre discipline. Et qui parfois mettaient celle-ci, et ses collègues, à l’épreuve. A l’épreuve d’une pensée vive, audacieuse et libre, Pierre Tripier savait penser hors des cadres. Il savait aussi faire partager cet enthousiasme à s’aventurer hors des sentiers de l’orthodoxie disciplinaire pour enrichir la sociologie, ses perspectives et ses travaux. Il gardait sur elle la fraîcheur du regard de ceux qui y arrivent après être passés par un autre monde professionnel. Il avait aussi l’espièglerie de ceux qui survolent le monde sans peur de s’y abimer. Et par-dessus-tout, une immense générosité qui le faisait penser aux autres en toutes choses. Toujours avec sourire, joie et un regard pétillant et malicieux.
Avec Pierre Tripier, la sociologie était une science vivante et alerte, généreuse et exigeante, qui savait sortir avec audace de ses limites. Que cet esprit sociologique vive longtemps !
Pour l’Ases, Valérie Boussard
Hommage de Jean-Pierre Terrail
Pierre a aimé et épousé une militante communiste, juive égyptienne immigrée de surcroît… affirmant ainsi son indépendance d’esprit, lui qui venait d’un tout autre horizon. C’est à cette époque que je l’ai connu, et participé à l’été 1966 à leur voyage de noces, organisé collectivement à Tropéa, beau village calabrais de la côte amalfitaine. « Collectivement » : Pierre et Maryse étaient en effet accompagnés et entourés par une douzaine de membres du groupe d’apprentis sociologues et anthropologues, la plupart adhérents ou proches du PCF, que nous étions alors. Je les retrouvais pendant l’année au resto U, Mabillon ou Mazet, avant le café-calva au bistrot de la rue de Nesles. Avec la Sorbonne c’était notre triangle d’or, notre territoire, le quartier latin était notre terrain de jeu. Les aléas de nos carrières universitaires nous ont éparpillés, mais nous nous sommes rarement perdus de vue complètement. Pierre était le plus âgé du groupe, sa taille et sa sagesse faisaient déjà de lui une référence et lui valaient un respect certain. Il avait beaucoup lu, il continuait à lire beaucoup. Cela comptait, pour nous pour qui le savoir était une valeur supérieure mais tout aussi bien une passion prégnante, omniprésente. Je me souviens que c’est lui qui m’a introduit à la lecture d’Althusser, qu’il m’avait recommandée avec enthousiasme, ce qui est un peu ironique puisqu’il adoptera bientôt de tout autres horizons intellectuels, alors que je resterai pour ma part bien plus longtemps sous l’influence du philosophe de la rue d’Ulm.
C’est surtout dans la seconde partie de ma vie professionnelle, une fois passée ma thèse d’État, que nous avons noué des relations plus étroites et que j’ai vraiment appris à le connaître. Je quittais alors Caen pour l’université de Nancy où j’avais été nommé professeur et j’avais décidé de m’investir dans les instances collectives de la profession. Il était difficile de ne pas l’y rencontrer. Lui de son côté quittait Besançon pour Nanterre, et œuvrait à la constitution d’une association entendant contribuer à l’autogestion collective de la discipline. Je me suis joint à l’entreprise, en devins responsable pour les universités du grand Est, et nous prîmes, Pierre et moi, l’habitude de nous retrouver pour notre promenade du dimanche matin. Une habitude qui se poursuivra une bonne trentaine d’années, depuis la fin des années 1980 jusqu’à ce que l’usure de l’âge l’empêche de s’y tenir. Il aimait bien marcher, moi aussi, il nous rejoignait aussi l’été passer une semaine en montagne avec nous. Nos liens se resserrèrent encore lorsqu’il fut chargé de monter un département de sociologie dans la nouvelle université de Saint-Quentin-en -Yvelines, où il me fit venir en 1994. Je lui en suis particulièrement reconnaissant, car je passai là les quinze plus belles années de ma carrière. L’ambiance de travail qui régnait à St-Quentin était de celles qui vous rendent heureux d’aller chaque jour accomplir vos obligations professionnelles ; et elle devait beaucoup aux qualités humaines de Pierre et à la façon dont il faisait vivre l’institution.
Je ne sais combien d’heures nous avons marché ensemble en devisant de choses et d’autres, mais le total doit être assez impressionnant. Je crois qu’il y avait pourtant assez peu, dans nos échanges, de ce bavardage qui ne craint jamais de s’épuiser en anecdotes de détails insignifiants et sans intérêt pour l’autre. Pierre était sociologue jusqu’au bout des ongles : tout événement menu de la sphère professionnelle ou familiale était pour lui un objet potentiel d’analyse microsociologique, sans jugement de valeur tapi à l’arrière-plan. J’ai beaucoup tiré profit, pour ma part, de cette posture de mise à distance, de débat et d’analyse. Il ne prenait jamais rien pour argent comptant. Quand j’avançais une idée, que j’esquissais une hypothèse, et interrogeais son assentiment, il n’acquiesçait jamais d’emblée. Même s’il était a priori plutôt d’accord, il commençait toujours par répondre : « Non, mais… ».
Constant dans sa posture de pensée, il était très cohérent dans ses pratiques quotidiennes. Féministe, il l’était intellectuellement par sa contribution aux publications spécialisées de la discipline, institutionnellement par ses encouragements insistants auprès de nos jeunes collègues femmes afin qu’elles brisent le plafond de verre et accèdent aux responsabilités professorales, familialement par son souci d’égalité domestique : « J’ai un principe, nous avait-il confié : ne jamais laisser seule une femme à la cuisine ». Attaché à la justice sociale et à l’égalité républicaine, je n’ai jamais constaté, dans la façon dont il exerçait ses responsabilités universitaires, de concessions au favoritisme ou à quelque clientélisme. Soucieux de la qualité du travail professionnel, il avait soin de ses étudiants, et j’ai fait mon miel, à SQY, de certains de ses principes pédagogiques. Il avait reçu les palmes académiques : ce qui m’aurait paru désuet et quelque peu dérisoire dans d’autres circonstances me semblait tout à fait approprié le concernant.
Pour autant, et cela contribuait à son charme, il n’était pas dénué de paradoxes. Celui qui me frappait le plus opposait sa farouche revendication d’empirisme absolu et son goût pour la spéculation théorique, qu’il nourrissait de découvertes livresques incessantes, essayant des grilles de lecture successives où je m’essoufflais à essayer de le suivre, y trouvant en tout cas l’avantage de ne jamais m’ennuyer. Me paraissait tout aussi paradoxale sa propension à traquer le moindre soupçon de déterminisme sociologique, et à afficher sa distance à l’égard de toute approche culturaliste du social au profit d’un interactionnisme radical, d’un côté, alors qu’il assumait si manifestement, de l’autre, l’héritage d’un longue lignée familiale de grands serviteurs de l’État ; et qu’il montrait, par son talent de négociateur, son sens de la réserve et de la dignité, son aisance dans tous les milieux et toutes les circonstances, tout ce qu’il devait à sa naissance dans la famille d’un ambassadeur.
Pierre, tu étais quelqu’un de rare, et j’ai été heureux de bénéficier de ton amitié pendant tant de décennies.
Jean-Pierre Terrail
Hommage de Víctor Zúñiga
J’ai rencontré Pierre il y a trente ans. Il était venu chez moi, à Monterrey, au Mexique, pour suivre l’avancée de la thèse de Delphine Mercier. Son départ représente pour moi l’adieu à l’un des êtres humains les plus profonds, les plus lumineux, que j’aie croisés dans ma vie. À travers ces lignes, je voudrais évoquer trois moments partagés avec lui — trois éclats de mémoire, à la fois légers et inoubliables, où affleuraient son intelligence vive, sa vitalité, son humour subtil, son humanité généreuse, et l’acuité si particulière de son regard sociologique.
Premier moment – Monterrey novembre 1995
J’avais eu l’idée d’emmener Pierre visiter les anciens quartiers industriels de Monterrey, où subsistaient encore les vestiges des premières usines, celles qui avaient lancé l’industrialisation de la ville — l’une des premières cités industrielles d’Amérique latine. Nous avons sillonné la ville en voiture, en partant des bâtiments fondés entre 1889 et 1892 : les aciéries, les métallurgies, dont la plupart avaient depuis disparu.
En chemin, je lui ai expliqué : à la fin du XIXe siècle, Monterrey ne comptait pas d’ouvriers. La ville et sa région étaient peuplées de cowboys, non de travailleurs d’usine. Alors, comment les entrepreneurs s’y sont-ils pris ? Ils ont fait venir des ingénieurs et des ouvriers d’Allemagne, d’Italie, de Belgique, d’Espagne, de France. Ces hommes, me suis-je permis de lui dire, aimaient la bière. Or il ne peut y avoir d’ouvriers sans bière. C’est ainsi qu’est née la brasserie — aujourd’hui l’une des plus grandes au monde. Mais pour produire de la bière, il faut des bouteilles en verre, des capsules, du carton pour les caisses, de la glace pour la rafraîchir… C’est ainsi, en quelques années à peine, qu’un véritable écosystème industriel s’est mis en place.
Pierre m’a alors lancé, avec un sourire complice : « Voilà exactement comment il faut construire les explications sociologiques : il n’y a pas d’ouvriers s’il n’y a pas de bière. »
Nous sommes ensuite allés lever nos verres dans une brasserie du centre-ville.
Deuxième moment – Paris, mai 2010
Cette année-là, Pierre et Maryse Tripier m’avaient invité à intervenir dans un séminaire sur les migrations, animé par Maryse à l’université Paris VII. Après la séance, Pierre m’a proposé de déjeuner dans un petit restaurant du quartier. Là, par hasard, nous avons croisé trois intellectuels — des philosophes et sociologues parmi les plus éminents de France — assis à une table, en pleine discussion animée. Pierre les connaissait bien. Ils le connaissaient aussi. Il les a salués avec simplicité, puis m’a présenté : « Voici un ami sociologue mexicain. »
À peine sortis, Pierre me confia : « Tu vois, ces trois-là publient aujourd’hui des idées qui contredisent ce qu’ils écrivaient dans leur jeunesse. Et pourtant, les gens continuent à lire leurs premiers écrits. C’est pourquoi je propose une loi universelle : interdire aux auteurs de publier quoi que ce soit avant l’âge de 60 ans. Tu comprends, entre 20 et 40 ans, les auteurs pensent qu’ils sont intelligents, mais les autres savent qu’ils sont idiots. Entre 40 et 60, ils continuent à se croire brillants, et les autres commencent à penser qu’ils le sont peut-être. Mais après 60 ans, les auteurs savent bien qu’ils sont stupides, tandis que tout le monde est persuadé qu’ils sont des génies. »
Troisième moment – Paris 30 janvier 2025
Le 30 janvier, je suis allé voir Pierre pour la dernière fois, à l’hôpital Sainte-Perrine, Unité Beausoleil, chambre 257. La veille -29 janvier-, je lui avais offert un recueil contenant presque toutes les chansons de l’un des plus grands auteurs de corridos mexicains : Julián Garza. Je lui ai raconté ce que représente le corrido dans notre création littéraire : un chant héritière de la tradition des romances espagnoles, une forme populaire, poétique et orale, qui raconte des histoires marquantes, dignes d’être transmises de génération en génération.
Je lui ai expliqué que les compositions de Julián Garza étaient profondément enracinées dans le parler rural du nord-est du Mexique. J’ai craint que Pierre ne puisse tout saisir — malgré son espagnol remarquable, mais d’Argentine. Et pourtant… quelle surprise : le lendemain, en entrant dans sa chambre, je l’ai trouvé plongé dans le livre. Il avait déjà lu une trentaine de pages. Il m’a dit : « Ces histoires sont adorables. Ce sont elles qu’il faut continuer à raconter. »
Je lui ai alors proposé de lui lire l’un de mes corridos préférés, intitulé Tres Tumbas (Trois tombes) :
Salieron de madrugada, se oía el cantar de los gallos,
iban a hacer dos jornadas a lomo de sus caballos;
la fiesta se celebraba en el rancho de El Pitayo.
Su padre les dio un consejo cuando a partir se apresaban:
cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba...
(Ils partirent à l’aube, tandis que chantaient les coqs.
Deux longues journées à cheval les attendaient ;
La fête allait se célébrer au ranch d’El Pitayo.
Leur père, avant leur départ, leur adressa un dernier conseil :
Prenez soin de votre peau, car la vie peut s’achever soudainement…)
Pierre a pleuré. Moi aussi. Les trois jeunes hommes de la chanson furent assassinés.
La leçon est claire : il faut écouter les conseils du père. Les derniers mots du corrido sont :
Un vieux solitaire, sans aucun espoir,
Il s’occupe du ranch, et a trois chevaux comme toute sa fortune.
De temps en temps, il va au cimetière
Visiter les trois tombes.
Pierre a alors saisi son crayon et a souligné le titre : Tres Tumbas.
Témoignage de Víctor Zúñiga, sociologue mexicain