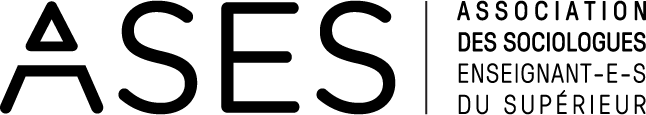Bref retour sur la condition universitaire, Christian Laval
par Christian Laval(1), professeur de sociologie, Paris Ouest Nanterre La Défense. Texte issu du mensuel du Snesup, n°614, avril 2013.
La régulation nouvelle de la recherche et de l’enseignement supérieur doit être comprise en relation avec les principales dimensions de la « nouvelle condition universitaire » que sont l’hétéronomie, la précarité et l’exploitation.
Les conditions de travail en milieu universi- taire se sont nettement dégradées, ce constat est presque unanime lorsqu’on écoute ceux qui ont assez de recul pour en juger. Allon- gement du temps de travail, alourdissement et multiplication des tâches, pression récurrente de l’évaluation et de la mise en concurrence pour l’obtention de crédits : les nouvelles contraintes s’ajoutent les unes aux autres jus- qu’à provoquer lassitude et parfois burn out. Le monde professionnel de l’enseignement supérieur et de la recherche n’échappe pas ou plus à une évolution générale qui voit « le métier » attaqué par des formes d’emploi, des pratiques managériales et des normes qui abî- ment le « travail », qui nuisent à l’ouvrage bien fait, qui méconnaissent la valeur de l’être et du faire. Le comble de la dégradation est bien sûr atteint avec l’extension de la précarité, et avec toutes les formes d’exploitation du travail gratuit auxquelles est tout particulière- ment tenu un nombre toujours croissant de jeunes chercheurs.
Mutation du travail universitaire : réduction progressive de l’autonomie du champ scientifique
Cette dégradation des conditions est en réalité à ressaisir dans une mutation plus large du tra- vail et du milieu universitaires, qui affecte conduites et subjectivités des professionnels. Hétéronomie, précarité et exploitation, ces trois dimensions de la « nouvelle condition uni- versitaire » sont inséparables de ce qu’on appelle « l’économie de la connaissance », c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs et des normes qui composent et imposent peu à peu une régulation nouvelle de la recherche et de l’enseignement supérieur. Certains, qui n’en connaissent ni l’origine ni la portée, ont voulu voir dans cette expression une recon- naissance de la valeur sociale de la connais- sance. Elle signifie plutôt que la connaissance doit désormais être regardée comme une valeur strictement économique, de première importance sans doute, mais pour une raison fondamentale qui n’a plus grand-chose à voir, du moins directement, avec la « vérité », un mot d’ailleurs assez désuet dans le lexique officiel du « pilotage ». Cette valeur de la connaissance trouve son fondement non plus dans une meilleure compréhension du monde, comme c’était le cas peu ou prou dans l’ancien « esprit de la science », mais dans son effica- cité opératoire, ou mieux dans la performance économique qu’elle permet d’améliorer. L’évolution n’est pas nouvelle, elle n’est pas seulement française, pas plus qu’elle n’est endogène au seul univers des savoirs et de l’enseignement. Cette transformation est pro- fondément liée à la fois aux transformations du capitalisme et aux politiques néolibérales mises en œuvre par les États. Ce qui caractérise, dans la pratique, cette nouvelle régulation de l’université et de la recherche c’est la dépen- dance politique à l’égard d’instances elles- mêmes soumises aux impératifs de « compé- titivité », c’est la réduction progressive de l’autonomie du champ scientifique par les modalités de son financement et de son éva- luation, c’est sa normalisation par la mise en œuvre, en son propre sein, des normes du marché et de la logique concurrentielle. On aurait tort de croire en effet que l’hétéronomie, terme qui traduit exactement « l’autonomie » promue par les réformes, s’impose par la seule pression externe des marchés et des poli- tiques qui en relaient les exigences. C’est de l’intérieur, par des normes dites d’excellence, ar des dispositifs dits d’auto-évaluation, par la professionnalisation dogmatique des cursus, et évidemment par le contrôle du « transfert de la recherche au monde socio-économique » que se refaçonne le milieu universitaire, en entraî- nant le plus de monde possible dans cette logique afin que les enseignants et chercheurs contribuent par leurs propres conduites, pousés par la situation de concurrence et/ou de précarité qui leur est faite, à la fabrication de « l’entreprise » uni- versitaire chargée de la production des connaissances utiles et rentables. C’est sous cet angle qu’il faut lire la loi Fioraso qui met en musique le « modèle greno- blois » théorisé par Michel Destot et soutenu par la fraction pro- entrepreneuriale du parti socialiste et du gou- vernement. Elle prolonge et même accentue très nettement la tendance en promouvant ce que M. Destot appelle l’« écosystème de l’in- novation reposant sur le triptyque univer- sité/recherche/industrie ». C’est également sous cet angle qu’il faut ana- lyser désarroi, désabusement et colère d’une grande partie du milieu. La liste des maux ne suffit sans doute pas à cerner leur cause. Si les conditions objectives se détériorent, il faut tenir compte aussi des agressions subjectives subies par les professionnels, des conflits éthiques dans lesquels ils sont sans cesse placés, des injonctions et des obligations qui les mettent en contradiction avec eux-mêmes. Pour le dire d’un mot, la régulation néolibérale du champ de la connaissance ne peut qu’abîmer le « cœur » du métier, c’est-à-dire les valeurs col- lectives partagées qui donnent à chacun le sentiment que son travail et sa vie ont un sens qui dépasse les intérêts et les conforts person- nels. Ce sont, je crois, ces subjectivités blessées qui rendent encore plus insupportable la dégra- dation des conditions objectives.