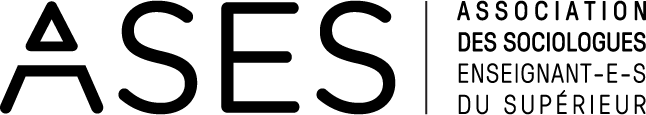Enquête. Les comptes des universités françaises sous la LRU
Entretien avec Jérémy Sinigaglia, MCF à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, SAGE (CNRS UMR 7363) Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe
Une enquête sur les « Comptes des universités » a été lancée par l’ASES. De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une enquête collective, réalisée au sein d’un Groupe de travail composé de membres de l’ASES. L’idée a germé en 2011 et l’enquête a débuté l’année suivante. Au départ, le groupe était composé d’Odile Henry, Sandrine Garcia, Natalia La Valle, Yann Renisio et moi-même, avec en soutien Vérène Chevalier, Fanny Darbus et Fanny Jedlicki. Nous avons été rejoints plus récemment par Benjamin Lemoine, Ana Perrin-Heredia et Laurène Le Cozanet. C’est un groupe à géométrie et à investissement variables, on avance comme on peut et quand on peut, en fonction de nos diverses contraintes.
L’objectif de ce travail était, dès le départ, à la fois scientifique et militant. Au plan scientifique, nous voulions comprendre les logiques de l’endettement des universités, dont nous n’avions chacun qu’une connaissance partielle, liée à notre propre expérience du système universitaire[1]. C’est pour cela que nous avions nommé ce groupe de travail « Comptes des universités ».
L’enquête repose sur une série de monographies réalisées dans sept universités, avec des degrés d’avancement et d’approfondissement différents : Créteil, Paris Sud, Grenoble, Aix Marseille, Strasbourg, Lorraine et Versailles Saint-Quentin, et nous aimerions intégrer dans l’échantillon Paris 1 et Amiens. Chaque monographie repose sur deux types de matériaux. D’une part, nous avons réalisé une série d’entretiens avec des collègues membres ou anciens membres du Conseil d’administration de leur université, et
parfois avec des membres d’autres conseils centraux. Nous n’avons pas toujours pu éviter la « langue de bois », selon la position occupée par ces collègues (plus ou moins impliqués, à titre personnel ou selon leur appartenance syndicale, dans la gestion des établissements). C’est néanmoins déjà une information, qui invite à prendre en compte les positions et les trajectoires des membres des CA pour comprendre leurs choix de gestion. D’autre part, nous avons procédé à l’analyse de documents officiels tels que les bilans financiers et les bilans sociaux. Ici, la principale difficulté tient à l’absence de données systématisées ou uniformisées. Les bilans sociaux sont rarement disponibles, ou très tard, malgré l’obligation légale, et les bilans financiers n’ont pas une écriture homogène, ce qui rend très difficile leur lecture et leur comparaison, tant d’un point de vue diachronique que synchronique. Nous travaillons encore à la construction d’indicateurs qui permettraient de comparer les universités. L’autre difficulté tient au fait que la plupart des universités (de notre échantillon mais aussi au-delà) sont engagées, à des stades plus ou moins avancés, dans un mouvement de concentration, du type fusion, association ou COMUE, qui rend très difficile l’analyse de l’évolution des situations budgétaires avant/après fusion, tout comme il est difficile d’évaluer le coût même des fusions.
Assez rapidement, l’objet s’est élargi à la problématique des conditions de travail des personnels. C’est cette deuxième phase de l’enquête que nous allons mettre en œuvre dans les semaines et les mois qui viennent.
Mais, comme je le disais, ce travail a aussi un objectif militant : nous souhaitions aussi en quelque sorte, pour reprendre une expression consacrée, « armer la critique » et apporter notre modeste contribution aux mobilisations en cours et à venir. Il s’agissait donc d’activer nos compétences de sociologues pour comprendre et lutter contre la situation que nous vivons actuellement.
Comment décrire la situation des universités aujourd’hui ?
La situation des universités, on commence à la connaître assez bien : elle est inquiétante, quels que soient les indicateurs que l’on mobilise pour produire l’état des lieux.
L’élément déclencheur de notre enquête, c’est la déclaration « en faillite » de 11 universités en 2011. Elles étaient 12 en 2012, 15 en 2013. C’est comme cela qu’on a commencé à s’intéresser au budget des universités. Or, malgré les promesses présidentielles de « sanctuarisation », celui-ci est en baisse. Une baisse certes faible – de 0,5% entre 2013 et 2014 pour atteindre 12,8 milliards d’euros – mais avec la « loi de finances rectificatives » du budget 2014, il manquerait, selon la Conférence des Présidents d’Universités, 160 millions d’euros au budget 2015, soit une baisse de 1,25%.
Cette situation a des effets visibles sur l’emploi, notamment sur les postes d’enseignants-chercheurs (EC). En 2014, 2500 postes ont été mis au concours, toutes sections CNU confondues, MCF et PU inclus ; en 2009, il y avait 1000 postes de plus mis au concours, alors que le nombre de départs en retraite est assez stable, voire a eu tendance à augmenter.
Concrètement, cela signifie que les universités fonctionnent avec un nombre très insuffisant de personnels permanents, et compensent en partie ce manque par des personnels précaires. Cela produit des effets sur les conditions de travail des personnels, bien analysés par Fanny Darbus et Fanny Jedlicki[2]. À l’Université de Strasbourg par exemple, l’une des universités sur lesquelles j’ai enquêté, on est à 342 emplois de titulaires (dont la moitié sont des enseignants- chercheurs), ce qui la situe sous le plafond d’emploi autorisé par le ministère. Parmi ces emplois, il y a les fameux « postes gelés »,
des supports d’emploi non remis au concours suite à un départ en retraite ou à une mutation ; ils sont au nombre de 34 dans cette université.
Cela génère aussi des effets sur les conditions d’enseignement, puisque les difficultés financières et la baisse des postes se produisent dans un contexte où le nombre d’étudiants ne cesse d’augmenter. Cela fait partie de ces injonctions politiques paradoxales adressées à l’université : il faut faire des économies et en même temps augmenter le nombre de jeunes diplômés du supérieur, avec un objectif en France établi à 50% d’une classe d’âge en 2020. Injonction paradoxale, donc, puisqu’on assiste à une baisse sans précédent de la dépense moyenne par étudiant, notamment depuis 2010 : faites mieux avec beaucoup moins !
Forcément, la baisse du taux d’encadrement se répercute au niveau de la formation : moins d’enseignants, moins de moyens, plus d’étudiants... donc moins d’enseignement ! En 2012, la présidence de l’Université de Strasbourg s’est fixé comme objectif une réduction de 80 000 heures de cours, soit une baisse de 13,3%. Cet objectif est partiellement atteint aujourd’hui, avec une baisse 48 000 heures en 2 ans. Dans de nombreuses universités, on assiste ainsi à une diminution du nombre de semaines de cours, à des suppressions de cours pourtant inscrits dans les maquettes validées par le ministère, à une diminution du nombre de groupes de TD et donc à une augmentation de leurs effectifs. Ces mesures produisent inévitablement une dégradation des conditions d’enseignement et d’études.
Enfin, les difficultés budgétaires se répercutent aussi sur l’entretien des bâtiments, via des économies réalisées sur les frais de maintenance, comme l’illustrent très bien les photographies publiées sur le Tumblr « universités en ruine »[3]. À Strasbourg, l’Université consacre 5 millions d’euros par an à l’entretien et à la maintenance des bâtiments alors que la dépense nécessaire est évaluée à environ 20 millions par an.
On pourrait en rajouter mais voilà quelques éléments qui définissent la situation actuelle de l’Université.
Comment en est-on arrivé là ? La loi LRU est-elle en cause ?
Oui, tout à fait. Mais la loi LRU doit être vue comme une forme d’aboutissement d’un long processus de réformes plus que comme un point de départ. Je ne vais pas me lancer ici dans une archéologie des réformes universitaires, même s’il y aurait beaucoup à dire. On pourrait remonter loin, avec par exemple la « loi d’orientation sur l’enseignement supérieur » de 1984 (la loi Alain Savary, ministre de l’éducation du gouvernement Pierre Mauroy), qui se présentait déjà comme un loi « d’autonomie » des établissements, tout comme la loi « Faure » de 1968, qui a consisté à accorder l’autonomie financière des établissements à partir d’une dotation globale de fonctionnement[4].
Mais pour expliquer la situation actuelle, il me semble pertinent de remonter au moins au processus de Bologne et à la stratégie de Lisbonne. En 1998, Claude Allègre, ministre de l’éducation du gouvernement de Lionel Jospin – celui qui voulait « dégraisser le mammouth » de l’éducation nationale – a été à l’initiative d’une déclaration à la Sorbonne qui a inauguré la construction d’un Espace européen de l’enseignement supérieur. Cette déclaration a été ratifiée par plusieurs ministres de l’enseignement supérieur en Europe et suivie de la mise en place de ce que l’on appelle le « processus de Bologne », qui construit un marché européen de la formation et qui, concrètement, instaure une forme de concurrence, de compétition internationale entre les établissements d’enseignement supérieur. Ce processus a été renforcé en 2000 par la « Stratégie de Lisbonne », dont l’objectif était que l’Europe devienne « l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde ». C’est ce qui a donné lieu en 2002 à la réforme LMD, visant à uniformiser le système d’enseignement au niveau européen.
Pourquoi je raconte tout cela ? Parce que dans le « processus de Bologne », il est indiqué que la « rigidité » du système administratif universitaire français (son mode de financement, le statut de ses fonctionnaires) constitue un frein à la
compétitivité des universités sur le plan international.[5]
Dans les années qui ont suivi, on a donc assisté à des réformes visant à assouplir ces rigidités. Comme la question des « statuts » des fonctionnaires est trop sensible pour être attaquée frontalement, les réformes ont porté surtout sur les modes de financement de l’université et sur l’évaluation de l’activité, via la création d’agences comme on en trouve dans de nombreux autres domaines de l’action publique.
En 2005, est créée l’Agence nationale pour la recherche, qui est chargée de financer une partie de l’activité scientifique à partir de projets. Or ce financement au projet est incompatible avec la pérennisation des emplois : les laboratoires embauchent des doctorants et surtout des post-doctorants, bien heureux de trouver un emploi, mais dans des conditions de précarité importante... En 2007, est créée l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES), qui est chargée, comme son nom l’indique, d’évaluer la manière dont les universités assurent leurs missions d’enseignement (nombre de diplômés, taux de réussite...) et de recherches (avec le
52
développement de
« bibliométrique » de la chercheurs).
la mesure production des
Entre les deux, on peut mentionner la création, en 2006, des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), visant à regrouper les établissements, et remplacés en 2013 par les « communautés d’établissements » (ComuE)... Je ne développe pas, mais on est toujours dans ce même processus de rationalisation des administrations publiques.
Le dernier étage de la fusée, c’est le vote en 2007 de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, dite « loi LRU» ou «loi Pécresse» du nom de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du gouvernement Fillon. Cette loi est l’aboutissement d’un long processus qui conduit à l’autonomie budgétaire des établissements de l’enseignement supérieur. Quand elle a été votée, les universités avaient cinq ans pour passer aux Responsabilités et compétences élargies (RCE), c’est-à-dire à la pleine autonomie budgétaire et dans la gestion de leurs ressources humaines, avec des possibilités élargies de recrutement, la gestion des primes, etc.[6] Ce décalage dans le passage aux RCE explique la désynchronisation des situations de faillite ou de difficultés budgétaires.
J’ajoute un dernier élément : le changement en 2009 du mode de calcul des dotations ministérielles des établissements. On passe, pour aller vite, du système dit « San Remo » qui reposait essentiellement sur l’activité des établissements, au système dit « Sympa », Système de répartition des moyens à la performance et à l’activité, qui intègre davantage la question de la performance : taux de réussite en licence, nombre de doctorats délivrés, nombre de publications des chercheurs...
Quelles sont les logiques concrètes qui causent « l’endettement » des universités, et creusent leurs budgets ?
Les difficultés budgétaires des universités sont une conséquence directe du passage aux RCE : les universités doivent en effet disposer d’un fonds de roulement de 30 jours, c’est-à- dire d’une réserve budgétaire qui permette de financer un mois de salaires. Si elles descendent en dessous de 30 jours pendant deux années consécutives, elles sont menacées d’être placées sous la tutelle du rectorat. Selon un rapport de 2013 de Thierry Mandon (député PS de l’Essonne), sur les 96 universités passées aux RCE, six universités seraient en déficit, 38 auraient un fonds de roulement inférieur à 30 jours et 14 auraient un fonds de roulement inférieur à 15 jours[7].
L’enquête que nous avons réalisée a permis d’identifier très concrètement les mécanismes qui conduisent au grignotage du fonds de réserve et donc aux difficultés budgétaires.
Le principal responsable est le mécanisme du Glissement vieillesse technicité (GVT). Comme je l’ai dit, avec le passage aux RCE, les établissements ont la charge intégrale des frais de personnels dans le cadre d’un budget global. Or la dotation des universités fait abstraction de l’évolution de la masse salariale. Le GVT est le mécanisme par lequel évolue cette masse salariale. Cette évolution
est, d’une part, fonction de la progression des qualifications, et donc des traitements, mais aussi du simple « vieillissement » des personnels, et donc de l’avancement d’échelon. Et comme ces éléments renvoient aux statuts de la fonction publique, les établissements « autonomes » ne peuvent les maîtriser. Cette évolution est, d’autre part, fonction du solde des entrées et des sorties d’emploi. Et puisqu’on ne peut pas licencier les fonctionnaires, le seul moyen de réduire la masse salariale est de jouer sur les « entrées » : c’est-à-dire de « geler des postes », ne pas remettre au concours des postes vacants, et aussi de ne pas reconduire des contractuels et des vacataires.
L’enquête a cependant montré que ce GVT, souvent positif, ne pèse pas toujours de la même manière ni dans les mêmes proportions sur le budget des universités. Il est plus élevé dans les universités prestigieuses qui à la fois gardent plus longtemps leurs Maîtres de conférences et attirent de nombreux Professeurs ; c’est le cas de Paris 1, par exemple. En revanche, dans les universités plus modestes, parfois considérées comme des universités de début de carrière, le turn over est plus important et les fonctionnaires devenus plus « coûteux » sont plus fréquemment remplacés par de nouveaux fonctionnaires aux échelons plus modestes.
D’autres types de dépenses, variables d’une université à l’autre, sont engendrés par les nouveaux besoins créés par le passage à l’autonomie. Il y a par exemple des dépenses de communication, des frais de représentation, liés aux contraintes de visibilité et d’attractivité qui découlent de l’intensification des logiques de concurrence entre universités. Les universités sont gérées comme des marques, comme des entreprises en concurrence sur un marché. Elles consacrent alors parfois beaucoup d’argent à la création d’un logo par une entreprise de communication. Des dépenses importantes dites de pilotage pèsent également, du fait de leur accumulation, sur les budgets des universités. Elles concernent par exemple des audits, confiés à des cabinets de conseils, sur la réorganisation des services dans les cas des fusions ou des candidatures aux projets d’excellence (Labex, Idex...), pour des sommes pouvant atteindre plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d’euros. En 2008-2009, le cabinet Deloitte a ainsi facturé 580 000 euros son audit concernant la mise en place de la nouvelle université fusionnée à Strasbourg. Ces dépenses témoignent de la mise en place d’un véritable marché de l’audit censé préparer la mise en œuvre des réformes et profitant largement à ces cabinets privés. Dernier élément, sans prétention d’exhaustivité : dans certains cas, la logique gestionnaire contribue elle-même, de façon apparemment paradoxale, à alourdir à terme les dépenses, par exemple, quand elle conduit à diminuer significativement le nombre d’emplois de rang C (tels que les agents d’entretien) au profit d’emplois de rang B destinés à renforcer les équipes administratives dont les compétences sont nécessaires pour faire face aux contraintes de gestion imposées par la LRU.
Comment les établissements gèrent-ils la crise ?
C’est effectivement une question que nous nous sommes posée. D’une part, parce qu’à ce train-là, la totalité des universités devrait être en faillite ; or, ce n’est pas le cas. D’autre part, parce qu’on a constaté que des universités déclarées en faillite à un moment donné parvenaient, dès l’année suivante, à retrouver des situations d’équilibre budgétaire. Cela nous a amené à nous intéresser à la manière dont les équipes dirigeantes procédaient dans ce contexte difficile.
Pendant les premières années, les universités ont généralement tenté de maintenir le cap sans trop faire de changements ; pour ce faire, elles ont « grignoté » dans leur réserve afin d’assurer le fonctionnement de l’établissement. Mais quand le fonds est épuisé, ou presque, la seule manière d’éviter la mise sous tutelle est de procéder à des coupes ! Et on retrouve tous les éléments cités plus haut : le gel des postes (qui de transitoire devient pérenne avec un mécanisme de « gel tournant »), la réduction de l’offre de formation, l’augmentation du nombre d’étudiants par groupe, etc. On assiste
novlangue managériale ne dit pas autre chose que cela: bien que la règle prévoie l’ouverture d’un nouveau groupe de TD à partir de 45 étudiants, celle-ci ne sera appliquée que si l’on dépasse les 49 inscrits (en comptant sur l’éventuelle défection d’une partie des étudiants pour faire tenir ces groupes dans des salles qui peuvent rarement en accueillir autant).
C’est d’ailleurs toute la force de ces « réformes ». En réalité, en tant que telle, la LRU n’impose ni la réduction du nombre de postes, ni le sacrifice des conditions d’enseignement... Par contre, elle pose le cadre budgétaire qui contraint les équipes présidentielles, bon gré mal gré, à l’« effort de rationalisation» attendu. Il y a donc une forme de dilution et surtout de délégation de la responsabilité du ministère (MESR et Bercy) vers le niveau local des équipes dirigeantes, composées pour partie, rappelons-le, d’acteurs concernés, d’universitaires, sommés d’assumer ce qui est présenté comme « leurs choix ». L’effort de rationalisation est ainsi censé être perçu comme plus légitime dans la mesure où il est accompli et assumé par les acteurs eux- mêmes.
Si certaines techniques de gestion de la crise sont communes à l’ensemble des établissements, l’enquête a également montré que les stratégies de « développement des ressources » dépendent aussi des particularités locales. Par exemple, lors des fusions, certaines universités ont intégré un IUFM (ESPE), qui a constitué pour elles une réserve de postes permettant d’absorber en partie les effets de la crise. L’université de Créteil a ainsi bénéficié d’une réserve de 137 postes, qui ont été en partie redéployés en fonction des besoins. Autre exemple : si dans la plupart des cas l’augmentation des frais d’inscription ne peut légalement constituer un levier pour augmenter les recettes au niveau de la formation initiale, elle peut tout de même en être un dans trois situations : certaines composantes (comme les Instituts d’études politiques ou certaines Écoles de management au sein des Universités) bénéficient d’un droit dérogatoire à imposer des droits d’inscription plus élevés (et plusieurs l’ont fait) ; les Universités peuvent aussi créer des Diplômes d’universités (DU) dont les frais d’inscription ne sont pas cadrés nationalement (jusqu’à 400 euros de plus qu’une inscription en L1) ; enfin, les étudiants étrangers constituent une ressource intéressante car peuvent s’ajouter aux frais d’inscription limités par la loi des frais de dossier parfois très importants (justifiés par le travail administratif « supplémentaire » nécessité, de traduction notamment).
Plus largement, dans des établissements qui ont pour mission l’enseignement supérieur et la recherche, il y a logiquement deux axes principaux sur lesquels il est possible d’intervenir pour réaliser des économies ou augmenter les recettes : l’enseignement et/ou la recherche. Et l’intérêt de ce jeu est renforcé par le passage au système Sympa, où l’on gagne à être « performant » sur l’une et/ou l’autre mission. Notre enquête tend à montrer que les stratégies qui consistent à favoriser une dimension ou l’autre ne répondent pas prioritairement à des choix rationnels mais qu’elles sont au contraire largement dictées par les ressources dont disposent les Universités et à la position qu’elles occupent dans le champ universitaire, et donc à leur histoire.
Ces stratégies contribuent par ailleurs à renforcer la polarisation du champ voire, en partie, à le reconfigurer (la suite de l’enquête
nous permettra de préciser cette hypothèse). À un pôle, on trouve notamment les universités les plus prestigieuses, figurant éventuellement dans le classement de Shanghai, et qui possèdent des « raies brillantes » : cet autre terme de la novlangue managériale désigne les « points forts » des universités, comme par exemple la présence d’un prix Nobel. Ici la stratégie consiste plutôt à entretenir ces points forts et donc à valoriser la recherche et le principe de l’excellence. Et cela se fait parfois au détriment de la mission d’enseignement. À l’autre pôle, on trouve les universités qui ne possèdent pas ces « raies brillantes » et qui réduisent généralement d’abord les budgets recherche en tentant de maintenir autant que possible l’offre de formation, en termes de volume horaire et de diversité de parcours et d’options proposés aux étudiants.
Bien sûr, ces logiques ne créent pas les inégalités entre les universités, qui existaient déjà avant ces réformes. Mais il est clair qu’elles contribuent à la fois à les objectiver, ce qui correspond bien à l’idée d’une mise en concurrence des universités, et à les renforcer. Elles accentuent de fait la polarisation du champ universitaire. La suite de l’enquête nous permettra d’avoir une vision plus claire des reconfigurations de l’espace universitaire découlant de la mise en œuvre, à tous les niveaux, de ces réformes.
Notes
[1] Un premier article est paru en septembre : Odile Henry, Jérémy Sinigaglia, 2014, « De l’autonomie à la mise sous tutelle ? Contraintes budgétaires et stratégies gestionnaires des universités », Savoir/agir, n° 29, p. 15-24.
[2] Fanny Darbus, Fanny Jedlicki, 2014, « Folle rationalisation de l’enseignement supérieur et de la recherche. Universitaires en danger », Savoir/agir, n° 29, p. 25-34.
[3] http://universiteenruines.tumblr.com/
[4] Abélard (collectif), 2003, Universitas calamitatum : le livre noir des réformes
universitaires, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant.
[5] Sandrine Garcia, 2007, «L’Europe du savoir contre l’Europe des banques ? La construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 166-167, p. 80-93 ; Christian de Montlibert, 2004, Savoir à vendre. L’enseignement supérieur et la recherche en danger, Paris, Raisons d’agir.
[6] Corine Eyraud, 2013, Le capitalisme au cœur de l’Etat. Comptabilité privée et action publique, Bellecombe-en-Bauges, Editions du Croquant, coll. Dynamiques socio-économiques.
[7] Thierry Mandon, 2013, «Annexe n°38. Recherche et enseignement supérieur. Enseignement supérieur et vie étudiante », Rapport pour la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de Loi de finances pour 2013.