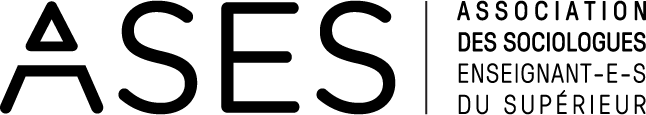Fiction - Bienvenue à l'Université Idéale
Par Andrea Bologna
Difficile dans le contexte actuel, entre processus de Bologne, loi Fioraso[1] et menaces sur les rémunérations des vacataires[2], de penser l’institution universitaire « idéale ». Imaginons-la pourtant, puisque la question est posée à la fois par les gouvernant.e.s, qui veulent faire passer leurs réformes, et par les opposant.e.s, qui en souhaiteraient d’autres. Fermez les yeux...
Des bâtiments qui pourraient être classés au patrimoine de l’UNESCO, quelque part dans le sud de l’Europe, en Espagne ou en Grèce peut-être. Le soleil méditerranéen, un vent doux dans une grande ville tout de même, afin d’offrir distractions et loisirs en parallèle à la connaissance. L’université idéale ne serait pas confinée aux frontières nationales, pas assez ambitieuses : elle alimenterait une nouvelle République des lettres, formant des générations d’humanistes sur l’ensemble du continent européen. La transmission des savoirs y serait facilitée par sa taille humaine et un taux d’encadrement particulièrement élevé, avec, par département, une dizaine de professeur.e.s pour une trentaine d’étudiant.e.s. Elle serait spécialisée en sciences humaines, avec seulement quelques disciplines: la sociologie – bien sûr – l’économie, le droit, l’histoire... peut-être la philosophie et la science politique. Elle aurait évidemment un budget conséquent, à la hauteur de son ambition : près de 60 millions d’euros annuels, pour environ 140 étudiant.e.s, une cinquantaine de professeur.e.s et une centaine de postdoctorant.e.s. Sa bibliothèque ferait pâlir d’envie la plupart des établissements français, de même que son nombre d’articles publiés dans des revues de rang A. On proposerait des missions financées pour passer du temps sur son terrain, des programmes d’échanges pour rencontrer, le temps d’un ou deux semestres, les universitaires d’ailleurs. Le taux de soutenance de thèses dépasserait 80 %. Un centre linguistique permettrait, gratuitement, aux plus motivé.e.s d’enrichir leurs connaissances en langues étrangères, de se perfectionner en anglais. L’équipe dirigeante soutiendrait les initiatives estudiantines, et mettrait d’importants moyens à disposition pour le sport et la culture. Sur le verdoyant campus idéal, il n’est pas rare de croiser un prof prenant une photo du soleil se couchant sur la ville, ou en short sur le terrain de foot, ou encore une guitare à la main dans le groupe de rock local. Le bar et les cafétérias permettraient à tous et toutes d’échanger, de dépasser les barrières sociales, et, pour une fois, de sortir de la rigidité des statuts professionnels, autour d’une cuisine locale variée, très appréciée. Des plaisanteries pourraient fuser, notamment à l’encontre des collègues du nord de l’Europe, peu accoutumé.e.s de ces plaisirs pourtant simples. Plusieurs soirées à thème rythmeraient d’ailleurs l’année académique, pour que les cultures européennes se rencontrent en dehors du domaine strictement universitaire et intellectuel. Proximité, dialogue, convivialité et surtout douceur de vivre.
Bien sûr, il y aurait aussi parfois quelques petites frictions, car, après tout, la vie en société implique nécessairement des malentendus, des maladresses, y compris entre personnes bien intentionnées. Et ce havre de paix, cet îlot entièrement consacré à la production de connaissance suscite à l’extérieur bien des incompréhensions et aussi, il faut à regret l’admettre, quelques jalousies. C’est donc de l’extérieur que viendraient les premières critiques, d’abord sur les processus de recrutement. Il faut dire que notre université idéale ne serait malheureusement pas ouverte à tout le monde. Son Directeur Général le regretterait, d’ailleurs, mais pour garder d’aussi belles conditions de travail, c’est un choix difficile mais nécessaire. Exit donc les licences et les masters : ici, on ne forme que de futur.e.s docteur.e.s, rémunéré.e.s et trié.e.s sur le volet. « On ne peut pas se permettre », dirait le Directeur Général, que nous nommerons l’Eminent Will E. E. Rough, « de reprendre toutes les bases. Nous faisons confiance à nos collègues de l’ensemble des établissements européens pour former nos jeunes pousses et encourager les meilleurs à poser leurs candidatures chez nous ». Les meilleurs, bien sûr, sont les fils, et parfois les filles, de la grande bourgeoisie blanche de l’Europe Occidentale, piaillent les critiques qui soulignent qu’en plus, les rémunérations varient du simple au triple ! Fonder une université internationale a un coût: il faut bien admettre que dans les différents pays concernés, les formes de contrats ou de bourses et leurs montants varient et changer ce système serait trop compliqué, à l’heure actuelle... Alors oui, reconnaîtrait encore Will E. E. Rough, les Danois.e.s et les Norvégien.ne.s font le même travail que les Grec.que.s et les Chypriotes, aux mêmes conditions, mais avec un salaire trois fois supérieur (de 3500 euros environ à 1050 euros) Et que dire de ces râleurs de Français.e.s et d’Espagnol.e.s qui ont obtenu un contrat avec une couverture sociale alors que la plupart des autres n’ont qu’une bourse et ne cotisent pas pour leurs retraites ! Mais ce n’est qu’une question de temps avant que tout ne s’harmonise. Et puis ce qui compte, c’est la qualité de la recherche. Pour assurer cela, Will E. E. Rough n’aime pas l’admettre mais le bâton fonctionne mieux que la carotte : chaque année, ceux et celles qui ne rendent pas des pages de la qualité exigée à la fin de l’année scolaire, s’ils et elles n’ont pas le soutien de leur directeur ou directrice, font l’objet d’une expulsion, après une vague procédure d’appel. L’adjoint de Will E. E. Rough précise:«Notre fonctionnement est un peu comme un contrat moral : chaque mois de juin est un crève-cœur, vraiment : les étudiant.e.s
rendent leur production et deux de leurs professeur.e.s décident si le passage à l’année supérieure leur est accordé. Malheureusement, chaque année, deux ou trois étudiants doivent nous quitter. C’est très dur pour nous.». Quand un soutien collectif s’organise contre une exclusion, le corps professoral fait bloc, intimide et pressurise. Il faut savoir, même dans l’université idéale, faire preuve de fermeté. De plus, le programme doctoral est aussi conçu pour faciliter la mobilité : depuis plus de trente ans qu’existe l’Université Idéale, aucun syndicat étudiant ne s’y est implanté : puisqu’on est dans une grande famille, pas besoin de s’organiser. Aussi, les étudiants et les étudiantes savent que leur développement professionnel est au cœur des préoccupations de la direction : pour alimenter leur CV, et puisqu’il n’y a pas sur place de licences pour « se faire la main », ne leur propose-t-on pas d’enseigner aux élèves plus jeunes des universités des environs ? Cette « formation » n’est certes pas rémunérée, mais si c’est pour gagner en expérience ! Du côté des personnels d’entretiens, même avec 60 millions d’euros et un tiers du financement venant du privé, notre université idéale a des contraintes budgétaires. C’est pour cela qu’elle externalise les services de nettoyage, de restauration et de conciergerie, cherchant toujours la compagnie la moins coûteuse, quitte à avoir en place des agent.e.s d’accueil rémunéré.e.s moins de 1000 euros par mois. Il faut dire qu’ils et elles n’ont pas les compétences des professeur.e.s, dont les revenus tournent autour des 10 000 euros mensuels : enfin sont récompensés à leur juste valeur le savoir et la connaissance.
Puisque les Bourdieu et Passeron d’aujourd’hui ne disposent pas du temps nécessaire pour mener une enquête en bonne et due forme, promenons-nous plus avant dans les délicieux jardins de cette Académie idéale. Quel plaisir de humer avec les grands penseurs européens des senteurs de lauriers et de thym ! Nous croisons dans les allées de jeunes gens bien mis, mais décontractés, chemises bien repassées sans cravate, petites robes grises, quelques centimètres au-dessus du genou, avec maquillage discret, cheveux lisses et barbes bien taillées. Le jean’s même, n’est pas si rare ; les gestes sont maîtrisés, des sourires discrets échangés lorsqu’on se détend entre deux cours, parfois autour d’un modeste buffet de traiteur, requis pour un colloque. Tout respire la convivialité. On se connaît, on se reconnaît. Il n’est pas compliqué à l’Académie de créer des liens personnels avec des supérieurs, parfois à l’aide d’un bon mot sur la difficile condition d’intellectuel ou, allez, d’une petite remarque sexiste sur les nouvelles premières années : la bonne humeur, bien sûr, avant tout, et au diable le politiquement correct. Notre université idéale en effet pratiquerait une réelle liberté d’expression et une réelle liberté académique. À travers la porte fermée d’une salle de classe, nous pourrions par exemple entendre un professeur expliquer qu’après tout le capitalisme a véritablement et largement amélioré la condition des femmes : pour preuve, dit-il, l’exploitation physique crasse dont sont victimes les femmes dans le monde musulman, ce monde musulman, continue-t-il, qui n’est pas (encore) moderne et non- capitaliste. Derrière une autre porte, un autre enseignant déplore l’impossibilité d’incorporer dans un programme de séminaire des textes féministes ou même écrits par des femmes: il serait tout disposé à le faire, évidemment, mais il se trouve malheureusement qu’il n’en existe pas sur la construction de l’Union Européenne. D’ailleurs, nous pourrions constater que l’ensemble du corps professoral prête une réelle attention à la cause des femmes : il existe une instance de lutte contre le harcèlement et même si la discrétion reste comme toujours importante – ce sont après tout des affaires privées et très sensibles – on ne nie pas qu’il puisse y avoir quelques problèmes comme ailleurs (Cardi, Pruvost, Naudier, 2005). Will E. E. Rough tempère : ce seraient, le plus souvent, simplement des petites incompréhensions dues à la diversité culturelle au sein de notre Académie. Et puis les petites erreurs, comme proposer un verre à l’une de ses thésardes ou confondre le pays de son thésard avec un autre dans ce grand continent qu’est l’Afrique, sont aussi tolérées puisque nous sommes de toute façon en bonne compagnie. Au fil de nos déambulations, nous comprendrions que cette communauté accepte avec joie les quelques personnes racisées qui franchissent ses portes et s’y sentent immédiatement à l’aise (Ahmed, 2007), jamais questionnées sur leurs origines, leurs
capacités à parler chinois ou swahili. Dans cette grande famille, bien sûr, les rapports sociaux de race n’existent pas, les quelques instances de discriminations ou remarques douteuses sur les origines nationales ou les appartenances religieuses sont prises avec sérieux, loin de constituer le fonds de commerce humoristique d’universitaires en mal de sociabilités. Sur et en dehors du terrain de foot ou des salles de classes, l’humilité semble d’ailleurs le maître mot de ces travailleurs et travailleuses de la connaissance : aucune vaine compétition pour dîner avec tel professeur ou participer à la conférence organisée par telle autre. La grandeur d’âme de chacun et la culture institutionnelle se rejoignent harmonieusement pour que tout se passe dans la plus grande transparence sur le plan universitaire. Appels publics à contribution, générosité intellectuelle, priorité aux membres « juniors » : on est ici bien loin de la logique de réseaux sclérosante et du favoritisme qui existe ailleurs [3].
Poussons désormais, en pensée toujours, la porte du prestigieux centre de recherche en science politique, le Centre Alcide de Gasperi, où travaillent une centaine de chercheurs, chercheuses et post-doctorant.e.s. La production scientifique étant exigeante et difficile à prévoir, les mêmes critiques venues de l’extérieur soulèvent quelques dysfonctionnements et, ô sacrilège, comparent la gestion du centre à celle d’une entreprise. Will E. E. Rough balaye ces inquiétudes et remarques désobligeantes d’un revers de la main : quel mal y a-t-il à vouloir que l’argent public soit utilisé de la manière la plus efficiente possible ? Bien sûr que tous les chercheurs et les chercheuses ne peuvent avoir un contrat unique, à durée indéterminée et à plein temps, puisque tous ne travaillent ni sur les mêmes projets ni avec les mêmes personnes ! On privilégie donc une multitude de contrats courts aux rémunérations très variables – il faut rester flexible –, quitte à les renouveler d’années en années... ou de onze mois en onze mois (pour éviter l’ouverture à certains droits sociaux et autres pesanteurs de l’administration locale). Ces contrats d’« assistants chercheurs » sont tellement faciles à utiliser qu’on y recourt massivement pour du temps partiel (complété par des heures supplémentaires pas toujours payées) ou même pour effectuer des tâches
administratives. Le chercheur du XXIe siècle aura ainsi appris à maîtriser de nouvelles compétences comme réaliser un budget, réserver restaurants et chambres d’hôtel, créer des affiches et relire les productions de son supérieur hiérarchique. La division entre recherche et administration, la précision sur l’intitulé des postes : des contraintes dont notre université idéale se serait, aux dires de Will E. E. Rough, heureusement affranchie depuis bien longtemps, au nom de la production des savoirs. Il est important que ces post-doctorant.e.s soient autonomes : tant pis s’il n’existe ni représentation dans les instances officielles de notre université idéale, ni structure pour résoudre leurs problèmes réglementaires et administratifs ou tout simplement pour donner accès aux informations concernant ces fameux contrats d’assistants-chercheurs. De toute manière, les portes du Doyen et du Directeur Général leur sont ouvertes, il suffit de demander.
Will E. E. Rough nous raccompagne devant le grand portail de l’Académie. Devant le soleil couchant qui embrase le ciel au- dessus de la ville en contrebas, il nous souhaite bonne chance, car il sait que réformer l’université française pour qu’elle atteigne ce niveau d’excellence ne sera pas une mince affaire, mais, ajoute-t-il, il a confiance : votre gouvernement est en bonne voie.
Notes
[1] https://www.solidaires-etudiant.org/blog/2014/10/02/loi-fioraso-transfo…- toulouse/
[2] https://mobprecvaclyon2.wordpress.com/
[3] https://www.laviedesidees.fr/Le-localisme-dans-le-monde.html
Dans la même tonalité, un collectif de jeunes enseignant.e.s-chercheur-e-s et chercheur-e-s, avait publié, en 2012 et 2013, à l’occasion des débats et mobilisations contre la loi sur l’ESR (dite « loi Fioraso », promulguée le 22 juillet 2013), trois papiers que nous vous invitons à relire :
Marc Sympa (Libération, 25 novembre 2012), Marta Savapétay (Mediapart, 6 mars 2013), Mikaël Sakkrifié (Mediapart, 21 mai 2013).