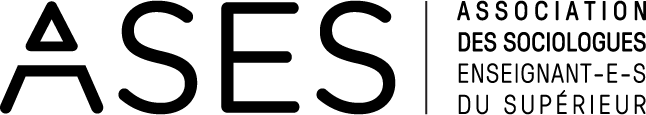Le projet Macron pour l’enseignement supérieur : une offensive sur le terrain de la valeur des études
Posté le 23 janvier 2018 par Aurélien Casta Mots-Clés :  Supérieur et recherche - Formation permanente - Alternative - Marchandisation / privatisation
Supérieur et recherche - Formation permanente - Alternative - Marchandisation / privatisation
Sur le site Questions de classe(s)
Une nouvelle réforme de l’enseignement supérieur a été annoncée par les ministres Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer. Pas encore adopté, le projet de loi (qu’on appellera loi Vidal dans la suite du texte) vise officiellement à remédier à « l’échec » en licence à l’université et à mieux informer les lycéens et les lycéennes des « attendus » des formations universitaires. Les personnels du lycée et de l’enseignement supérieur donneraient des avis sur les nombreux choix et projets (jusqu’à 10) formulés par les lycéens au cours de leur année de terminale. Les établissements sollicités formuleraient quatre types d’avis : « oui », « oui si », « en attente » et « non ». Dans le premier cas, le jeune pourra choisir cette formation. Dans le deuxième, il sera aussi accepté mais il devra effectuer un « parcours personnalisé », par exemple des enseignements supplémentaires dans les matières où il ne présente pas suffisamment de garanties. Les avis « en attente » ou « non » renverront le lycéen à un éventuel accord que lui donnerait finalement l’établissement ou un autre qu’il aurait sollicité, faute de quoi une commission présidée par le recteur aurait pour responsabilité de lui proposer une autre formation.
Il est possible d’analyser cette loi comme une attaque contre le droit d’accès à l’université de toutes les personnes détenant le baccalauréat ou un équivalent [1], avec le risque d’un retour en arrière dans les mobilisations scolaires des jeunes et des familles populaires [2]. Pour autant, les initiateurs de la loi ne souhaitent pas réellement baisser le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur. Si l’on en croit les échanges menés durant la campagne présidentielle de 2017 entre l’entourage du candidat Macron et le réseau de spécialistes du supérieur qui gravitent autour, l’objectif n’est pas celui-là.
Ces échanges de messages électroniques révélés par Wikileaks le 31 juillet dernier [3] mettent en lumière dans quelle mesure la loi Vidal fait partie d’un projet qui combine soutien aux « formations courtes professionnalisantes », hausse des frais d’inscription et développement des prêts étudiants. C’est ce que ce texte se propose de montrer. [4]

Pour ce faire, il faut remonter à un conflit qui n’a pas toujours été visible et qui s’est ouvert en France il y a plus d’un siècle autour de la valeur des études et du statut économique de l’étudiant. Il s’est noué dans les années 1870 au sujet de deux types d’établissements supérieurs : les universités publiques et les écoles privées. D’un côté, les partisans des écoles privées (établissements catholiques, Science po Paris, ...) sont parvenus à la suite de deux lois adoptées en 1875 et 1879 à légaliser ces établissements. Ils ont ainsi réussi à faire autoriser la sélection des étudiants, les frais d’inscription particulièrement élevés et la rémunération variable des enseignants qu’ils pratiquaient. De l’autre côté, les associations d’enseignants se sont opposées à ce que leur rémunération dépende des frais d’inscription collectés et du nombre d’étudiants inscrits dans leurs cours. Dans un contexte où les universités étaient ouvertes par principe aux bacheliers et avaient des frais d’inscription modérés par l’Etat, les universitaires ont revendiqué et obtenu en 1879 que leur traitement respecte une grille nationale de salaires qui s’applique sur tout le territoire selon les principes de la fonction publique d’Etat. Leurs positions ont pris une tournure encore plus radicale de 1943 à 1951 lorsqu’elles ont été intégrées dans un projet global de réforme de tout le système d’enseignement (qui prévoyait notamment l’intégration de toutes les écoles dans l’université publique). Ce projet a été demandé en 1943 par le Conseil national de la Résistance et révélé en 1947 au grand public à l’occasion de la parution du Plan Langevin-Wallon. Les syndicats étudiants ont été alors soutenus par d’autres organisations syndicales et des parlementaires qui sont parvenus à faire discuter à l’Assemblée nationale, en 1951, une proposition de « rémunération étudiante ». Dans ce projet et dans le Plan Langevin-Wallon, les étudiants étaient considérés comme des « travailleurs » qui produisent au cours des études. A ce titre, il était prévu que les frais du privé mais aussi les frais forfaitaires du public soient supprimés, que les études soient complètement « gratuites » et qu’un « salaire » soit donné aux étudiants.
Deux positions coexistent ainsi encore aujourd’hui. Elles opposent des partisans du droit d’accès des bacheliers à l’enseignement supérieur et leurs opposants qui soutiennent la loi Vidal. Le conflit porte fondamentalement sur la valeur des études et sur le statut économique de l’étudiant [5]. La valeur économique des études et de la formation est-elle, comme le pensent les initiateurs de la loi Vidal, la valeur capitaliste qu’elles produisent, directement dans les écoles supérieures payantes ou après les études une fois que les étudiants sont diplômés, occupent un emploi mieux rémunéré et remboursent le prêt qu’ils ont contracté (ici les étudiants sont des consommateurs et des personnes qui ne produisent de la valeur qu’une fois leurs études finies [6]) ? Ou est-ce que, comme ont commencé à l’affirmer dans l’esprit du Plan Langevin-Wallon les syndicats étudiants et une partie des organisations universitaires, une valeur économique non capitaliste est produite au cours des études gratuites par les personnels et par les étudiants (ici, les étudiants sont des travailleurs à qui il s’agit de donner un salaire) ? Pour trois raisons, on peut voir dans la loi Vidal une nouvelle attaque destinée à contrer les projets issus de l’après-guerre et à renforcer les pratiques et croyances fondatrices de la valeur capitaliste.
La sélection, un levier de la hausse des frais d’inscription
Premièrement, la loi Vidal s’inscrit dans un projet global dont l’aboutissement est la généralisation des frais d’inscription et le développement des prêts étudiants.
La loi a été préparée par un groupe réuni durant la campagne par la « plume » d’Emmanuel Macron, Quentin Lafay, et par l’ancien président de la communauté d’université Paris Sciences et Lettres, Thierry Coulhon. Avec eux, on retrouve des fonctionnaires, des universitaires, responsables d’établissement ou économistes ayant collaboré avec la Conférence des grandes écoles ou encore la Conférence des présidents d’université. [7] Les membres du groupe ont ainsi participé activement, aux côtés d’organisations patronales comme l’Institut de l’entreprise, à la relance des propositions en faveur de la sélection, de la hausse des frais d’inscription et du développement des prêts étudiants. Selon eux, la loi Vidal a en réalité le même statut que les réformes entamées depuis la fin des années 1990 (arrêtés Licence master doctorat dit « LMD », loi organique relative aux lois de finances souvent dénommée « LOLF », loi relative aux libertés et responsabilités des universités régulièrement appelée « LRU », …) : elle est considérée comme une transition nécessaire. Cette transition a été pensée selon les spécificités de l’enseignement supérieur français (notamment sa division ancienne entre universités et écoles). Elle a également été inspirée par les principes fondateurs et évolutions de l’enseignement supérieur des pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni.
 Le Royaume-Uni est un pays qui a longtemps été hostile à l’enseignement supérieur privé. Il a par contre toujours permis aux universités publiques de sélectionner leurs étudiants, au nom d’un principe d’autonomie des établissements lui aussi consacré depuis plusieurs siècles. Ce principe a permis aux directeurs d’établissements de mettre en place des rémunérations variables pour les enseignants-chercheurs et des frais d’inscription particulièrement élevés, notamment pour les personnes inscrites dans les cursus situés après la licence et dans des études à temps partiel. Ces dernières, qui correspondent en gros à la formation continue en France, ont un poids très important. Largement le fait d’étudiants salariés, elles concernent depuis les années 1960 entre 30% et 50% des effectifs. Il a fallu attendre l’après-guerre pour que les pratiques de sélection, de frais d’inscription et de rémunération auxquels avaient recours les universités commencent à être contenues. Les mobilisations des syndicats d’étudiants et de personnel à partir de 1945 ont notamment permis une plus grande ouverture de l’enseignement supérieur à de nouveaux publics et aux classes populaires. De 1960 à 1997, le nombre d’étudiants est passé de 130 000 à 1,8 million, la majeure partie des inscrits l’étant à temps plein au niveau licence. Les effectifs totaux du Royaume-Uni sont ainsi devenus similaires à ceux de la France. Cette évolution a reposé sur un dispositif de paiement par l’Etat et les collectivités locales des frais d’inscription de tous les étudiants à temps plein, ainsi que sur le versement de prestations assez élevées destinées aux frais de vie courante : l’award. Ce système garantissait ainsi indirectement un enseignement supérieur gratuit au niveau de la licence et des études à temps plein.
Le Royaume-Uni est un pays qui a longtemps été hostile à l’enseignement supérieur privé. Il a par contre toujours permis aux universités publiques de sélectionner leurs étudiants, au nom d’un principe d’autonomie des établissements lui aussi consacré depuis plusieurs siècles. Ce principe a permis aux directeurs d’établissements de mettre en place des rémunérations variables pour les enseignants-chercheurs et des frais d’inscription particulièrement élevés, notamment pour les personnes inscrites dans les cursus situés après la licence et dans des études à temps partiel. Ces dernières, qui correspondent en gros à la formation continue en France, ont un poids très important. Largement le fait d’étudiants salariés, elles concernent depuis les années 1960 entre 30% et 50% des effectifs. Il a fallu attendre l’après-guerre pour que les pratiques de sélection, de frais d’inscription et de rémunération auxquels avaient recours les universités commencent à être contenues. Les mobilisations des syndicats d’étudiants et de personnel à partir de 1945 ont notamment permis une plus grande ouverture de l’enseignement supérieur à de nouveaux publics et aux classes populaires. De 1960 à 1997, le nombre d’étudiants est passé de 130 000 à 1,8 million, la majeure partie des inscrits l’étant à temps plein au niveau licence. Les effectifs totaux du Royaume-Uni sont ainsi devenus similaires à ceux de la France. Cette évolution a reposé sur un dispositif de paiement par l’Etat et les collectivités locales des frais d’inscription de tous les étudiants à temps plein, ainsi que sur le versement de prestations assez élevées destinées aux frais de vie courante : l’award. Ce système garantissait ainsi indirectement un enseignement supérieur gratuit au niveau de la licence et des études à temps plein.
Les conseillers d’Emmanuel Macron ont repéré qu’il n’a été remplacé que très progressivement de 1982 à 1997. Au début des années 1980, le gouvernement de Margaret Thatcher n’avait pas beaucoup de soutiens universitaires pour ses projets de remplacement de l’award par des hausses des frais d’inscription et le développement des prêts étudiants. Ses adversaires se réclamaient de la traditionnelle conception élitaire d’une université ne relevant pas de la logique économique, et cette incapacité à poser l’enseignement supérieur comme producteur de valeur a rendu possible l’imposition de la pratique capitaliste de celle-ci dans un contexte de réduction des financements publics. Les gouvernements Thatcher ont su s’appuyer sur une partie des directeurs d’établissement, qui devaient faire face aux réductions de leurs subventions décidées par le gouvernement. Ils souhaitaient disposer, en plus de leur autonomie concernant le recrutement des étudiants, de réelles libertés pour fixer le montant des frais d’inscription en licence à la manière de ce qui était mis en place au-delà de la licence et pour les études à temps partiel. A partir de 1982, ces directeurs d’établissements ont été autorisés à fixer eux-mêmes le montant des frais d’inscription payés par les étrangers non ressortissants de l’Union européenne. Finalement, au tournant des années 1990, ces directeurs par le biais de leurs organisations représentatives ont fini par soutenir officiellement le remplacement général de l’award par la hausse des frais d’inscription et le développement des prêts étudiants.
A la lumière de ce qu’a connu le Royaume-Uni, l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron attend de la loi Vidal qu’elle encourage les aspirations à l’autonomie des établissements et de leurs départements dans un contexte de pénurie budgétaire similaire à celui qu’ont connu les universités britanniques dans les années 1980. L’une des notes discutées par l’équipe de campagne, consacrée aux formations « courtes » (Bac +3), annonce la loi Vidal en étant assez claire sur l’autonomie des établissements. La loi serait une invitation à « l’innovation », à la mobilisation du « "génie propre" » et « du talent spécifique des équipes pédagogiques ». Ces initiatives en licence viseraient plus fondamentalement à encourager les universités à augmenter leurs frais d’inscription à chaque fois qu’elles le peuvent comme pour les étudiants en formation continue que la note évoque directement comme une « source de revenus » et une « opportunité ». Les autorisations données aux établissements de recruter les bacheliers de leur choix s’intègrent ainsi plus globalement dans un projet de hausse des frais d’inscription pratiqués à l’université.
 Là aussi, le groupe s’est manifestement nourri de l’expérience britannique. L’award n’existe plus depuis 1997. Les frais d’inscription sont aujourd’hui équivalents à près de 10 000€ pour une année de licence. Ils sont accompagnés de deux types de prêt subventionnés par l’Etat [8] : des prêts équivalents au montant des frais d’inscription et des prêts dédiés aux frais de vie courante dont le montant maximal pour une année est compris entre 7 000€ et 12 000€. De façon inédite, les deux types de prêts subventionnés sont ouverts à des établissements privés à l’origine quasi-inexistants et désormais en plein développement. Cette expérience de développement massif des frais d’inscription et des prêts étudiants est bien connue des conseillers d’Emmanuel Macron.
Là aussi, le groupe s’est manifestement nourri de l’expérience britannique. L’award n’existe plus depuis 1997. Les frais d’inscription sont aujourd’hui équivalents à près de 10 000€ pour une année de licence. Ils sont accompagnés de deux types de prêt subventionnés par l’Etat [8] : des prêts équivalents au montant des frais d’inscription et des prêts dédiés aux frais de vie courante dont le montant maximal pour une année est compris entre 7 000€ et 12 000€. De façon inédite, les deux types de prêts subventionnés sont ouverts à des établissements privés à l’origine quasi-inexistants et désormais en plein développement. Cette expérience de développement massif des frais d’inscription et des prêts étudiants est bien connue des conseillers d’Emmanuel Macron.
Elle les a conduits à reprendre leur campagne en faveur de la hausse des frais d’inscription et des prêts étudiants qu’ils réclament depuis une quinzaine d’années [9]. Une autre note discutée par l’équipe de campagne, résume le projet global du candidat et reprend le livre-programme d’Emmanuel Macron paru en 2016 et sa proposition de « permettre aux universités de faire contribuer les étudiants les plus aisés » [10]. Cette proposition correspond à la mesure en place à Science po Paris et surtout à celle qu’a introduite en 1997 au Royaume-Uni le gouvernement de Tony Blair, classé à gauche. Le groupe a toutefois jugé cette mesure trop dangereuse politiquement. Il a préconisé qu’elle fasse au cours du mandat uniquement l’objet d’une « concertation ». Il a surtout proposé qu’elle soit précédée de mesures transitoires préparant une réforme systémique de ce type. La mise en place de prêts étudiants remboursables après les études (qui a eu lieu en 1990 au Royaume-Uni) et la hausse des frais d’inscription demandés aux étudiants inscrits en master (pratiquées avec constance au Royaume-Uni) ont ainsi été explicitement suggérées à Emmanuel Macron au cours de la campagne. Ces propositions transitoires n’ont reçu aucune opposition de la part de son entourage. Il en est une qui faisait particulièrement l’unanimité et qui devrait être proposée très rapidement car elle a reçu l’aval d’Emmanuel Macron qui s’y est dit officiellement « ouvert » bien avant l’élection du printemps dernier : comme en 1982 au Royaume-Uni, le gouvernement devrait très prochainement tenter de donner l’autorisation aux universités de fixer elles-mêmes les frais d’inscription demandés aux étudiants étrangers non ressortissants de l’Union européenne.
Encourager les universités à voir leurs étudiants comme des consommateurs et des futurs travailleurs
La deuxième raison pour laquelle la loi Vidal encourage les pratiques et croyances fondatrices de la valeur capitaliste est liée aux transformations de l’université que cette loi cherche à imposer. Comme on l’a vu, le Plan Langevin-Wallon et les mouvements étudiants ont renforcé le rejet de la valeur capitaliste en diffusant d’autres idées et pratiques qui se sont particulièrement répandues à l’université. Contre ces pratiques et idées, la loi Vidal soutient que l’étudiant de l’université est à la fois le consommateur d’une formation payante qui peut augmenter les ressources de l’établissement, et un futur travailleur qui produira dans l’emploi une valeur supplémentaire rendant possible le remboursement de prêts contractés pour ses études.
Le cas des universités est ainsi intégré à un projet global de relance des « formations courtes professionnalisantes » détaillée là encore dans la note sur les formations courtes évoquée précédemment. Certes, cette note et les échanges de l’équipe de campagne indiquent que la loi a bien pour ambition le développement dès le niveau licence de « parcours d’excellence » qui permettront aux universités « les plus intenses en recherche » de sélectionner les étudiants qu’elles destinent aux « études longues » et de concurrencer les classes préparatoires. Mais à lire les discussions, l’ambition principale de la réforme concernant les universités n’est pas celle-là. Lorsqu’ils évoquent la loi Vidal, les conseillers parlent beaucoup plus d’ « orientation » que de « sélection ». Si l’on suit la note, l’ambition principale est « d’une part de faire participer la plus large part de la population à l’économie de demain, et d’autre part de répondre de manière véritablement adaptée à la hausse des effectifs d’étudiants à venir ». Les conseillers ne souhaitent pas voir les effectifs de l’enseignement supérieur baisser. Le souhait exprimé dans la note est plutôt de développer des « "licences de métier" en décloisonnant dans un ensemble de parcours plus fluides et de passerelles, licences dites "générales", formations DUT et licences professionnelles ».
Dans l’esprit des conseillers, les licences de métier auraient à l’université le même rôle que la formation continue [11] : ces filières et modes d’études permettraient de changer radicalement la façon dont on se représente l’étudiant et l’étudiante à l’université. Pour le groupe de campagne, les universités devraient les considérer comme de futurs ou d’anciens travailleurs qui ne produisent pas au cours des études et qui en tant que consommateurs sont une « source de revenus » centrale pour les établissements. Leur mission est de les faire rentrer au plus vite sur le marché du travail, à la fois pour qu’ils soient prêts à payer leurs études et rapidement en capacité de rembourser les prêts. Le groupe veut pousser la majeure partie des universités à s’adapter à des publics que l’on destine principalement à « une insertion professionnelle immédiate ». Aux yeux des conseillers, c’est comme cela que l’on peut, comme au Royaume-Uni, pousser les universités publiques à changer leur conception de la valeur des études et du statut économique de l’étudiant et que l’on peut leur faire accepter la généralisation des frais d’inscription et des prêts étudiants. Si les universités s’abstenaient trop de mettre en place ce type de licence, les conseillers pourraient également s’appuyer sur l’enseignement supérieur privé qu’ils ont prévu de mobiliser pour augmenter le nombre d’étudiants et faire passer l’ensemble de leur projet.
Le recours à l’enseignement supérieur privé
En effet, la volonté d’encourager la valeur capitaliste et de changer le statut économique de l’étudiant s’appuie dans la loi Vidal sur le souhait de mobiliser les écoles privées, des établissements qui, contrairement aux universités, ont toujours considéré les étudiants comme des consommateurs d’études qui récupéreront les coûts engagés une fois dans l’emploi grâce à leurs suppléments de salaire.
Ce point a manifestement été moins discuté par les conseillers. Néanmoins, la note sur les formations courtes souligne (et surligne dans le texte) que c’est « l’ensemble de l’enseignement supérieur », y compris « les formations et écoles privées » que la réforme des « formations post-bac » doit « mobiliser ». Si l’on suit la note, les filières à encourager sont les suivantes : « les formations professionnelles courtes (2/3 ans) des lycées (BTS, BTSA et formations de même type), les formations sociales, paramédicales, des secteurs de la culture, de l’animation, de la jeunesse et des sports, les formations des chambres de commerce et d’industrie, des métiers ou d’agriculture, des autres formations supérieures courtes à vocation professionnelle ». On a là tout un ensemble de filières où établissements publics et privés coexistent notamment parce que depuis plus d’un siècle, comme nous l’avons vu, les écoles privées d’enseignement supérieur sont tolérées et même parfois soutenues par une législation qui leur est dans l’ensemble assez favorable.
Le secteur privé a ainsi pu se développer avec vigueur du début des années 1990 jusqu’à aujourd’hui et les écoles qui en font partie occupent dorénavant une place loin d’être négligeable. Comme le montre le graphique suivant, ces écoles connaissent une forte croissance de leurs effectifs qui leur permet aujourd’hui de réunir autour de 20% des 2,6 millions de personnes inscrites dans l’enseignement supérieur.
Évolution des effectifs de l’enseignement supérieur depuis 1990 (en milliers d’inscrits)
| 1990 | 1997 | 2000 | 2005 | 2012 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total enseignement supérieur | 1714 | 2132 | 2143 | 2283 | 2287 | 2610 |
| Universités publiques dont DUT | 1246 | 1505 | 1507 | 1425 | 1411 | 1624 |
| Lycées privés (BTS et classes préparatoires) | 93 | 85 | 86 | 79 | 78 | 80 |
| Établissements privés d’enseignement universitaire | 20 | 22 | 22 | 21 | 29 | 34 |
| Écoles d’ingénieur privées | 14 | 19 | 22 | 27 | 45 | 53 |
| Écoles privées de commerce, gestion, vente et comptabilité | 46 | 48 | 64 | 88 | 133 | 153 |
| Écoles privées juridiques et administratives | nd | nd | nd | nd | 4 | 5 |
| Écoles privées littéraires et de journalisme | nd | nd | nd | nd | 7 | 9 |
| Écoles privées paramédicales | nd | nd | nd | nd | 24 | 26 |
| Écoles privées préparant aux fonctions sociales | nd | nd | nd | nd | 39 | 31 |
| Écoles privées artistiques et culturelles | nd | nd | nd | nd | 30 | 31 |
| Écoles privées d’architecture | nd | nd | nd | nd | 1 | 1 |
| Autres écoles privées | nd | nd | nd | nd | 46 | 54 |
| Ensemble des écoles privées | 436 | 474 |
nd : donnée non disponible
Source : Ministère de l’éducation nationale - Repères et références statistiques
Sans qu’à aucun moment le privé ne soit explicitement exclu, il est prévu que ce soit sur les filières courtes au cœur des activités du privé que se concentre l’essentiel des financements supplémentaires dégagés au cours du mandat pour l’enseignement supérieur et la recherche. Bref, l’intention des conseillers est de développer les filières courtes délivrées notamment par le privé en créant les conditions pour que celles et ceux qui ne trouvent pas de places à l’université s’inscrivent dans ces filières.
Le développement de ce type d’écoles permettrait de poursuivre la diffusion dans l’enseignement supérieur de la pratique des frais d’inscription et des prêts étudiants. En effet, en plus de sélectionner, ces établissements proposent des frais d’inscription de l’ordre de plusieurs milliers d’euros qu’ils associent à des prêts du même montant fournis par des banques commerciales partenaires. C’est pourquoi, malgré leur poids encore limité, les écoles privées et entreprises lucratives de formation sont considérées par les initiateurs de la loi Vidal comme des acteurs légitimes de l’enseignement supérieur que l’on peut mobiliser au même titre que les universités publiques. Contre l’université publique, elles propagent des idées et des pratiques typiques de la valeur capitaliste et du statut économique de l’étudiant qui l’accompagne.
 On l’a dit, les idées et pratiques de la valeur capitaliste peuvent être remises en cause dans l’enseignement supérieur. Elles le sont depuis la fondation de l’université publique et les luttes sociales menées depuis le Plan Langevin-Wallon. Si l’on suit ces pratiques et ces luttes, l’enjeu est d’ores et déjà de réoccuper le terrain privilégié des défenseurs de la loi Vidal : le terrain de la valeur des études et du statut économique de l’étudiant. Contre la loi Vidal, contre des études soumises au marché du travail avec hausse des frais d’inscription et prêts étudiants, il y a tout à gagner à ne pas adopter une attitude similaire aux mobilisations britanniques des années 1980 et 1990 contre la disparition de l’award. A force de ne pas lier leur combat pour la réforme de l’enseignement et la gratuité du savoir à un discours autonome sur la valeur économique des études, ces mobilisations ont fini par laisser le champ libre à leurs adversaires et à des directions d’établissement contraintes, puis décidées, à adopter une pratique capitaliste de la valeur des études. Il y a au contraire tout à gagner à mener une lutte offensive sur la gratuité, une lutte qui porterait sur le statut de travailleur de l’étudiant et de l’étudiante et sur la production hors de toute logique marchande d’une valeur non capitaliste par des fonctionnaires universitaires et des étudiants ayant les uns et les autres droit à un salaire. Il y a tout à gagner même à ouvrir de nouvelles alliances avec les salariés et les personnes en reprise d’études puisque la prochaine réforme de la formation professionnelle a vocation à les faire passer elles aussi pour des personnes qui consomment leurs études payantes et ne produisent pas en dehors de l’emploi.
On l’a dit, les idées et pratiques de la valeur capitaliste peuvent être remises en cause dans l’enseignement supérieur. Elles le sont depuis la fondation de l’université publique et les luttes sociales menées depuis le Plan Langevin-Wallon. Si l’on suit ces pratiques et ces luttes, l’enjeu est d’ores et déjà de réoccuper le terrain privilégié des défenseurs de la loi Vidal : le terrain de la valeur des études et du statut économique de l’étudiant. Contre la loi Vidal, contre des études soumises au marché du travail avec hausse des frais d’inscription et prêts étudiants, il y a tout à gagner à ne pas adopter une attitude similaire aux mobilisations britanniques des années 1980 et 1990 contre la disparition de l’award. A force de ne pas lier leur combat pour la réforme de l’enseignement et la gratuité du savoir à un discours autonome sur la valeur économique des études, ces mobilisations ont fini par laisser le champ libre à leurs adversaires et à des directions d’établissement contraintes, puis décidées, à adopter une pratique capitaliste de la valeur des études. Il y a au contraire tout à gagner à mener une lutte offensive sur la gratuité, une lutte qui porterait sur le statut de travailleur de l’étudiant et de l’étudiante et sur la production hors de toute logique marchande d’une valeur non capitaliste par des fonctionnaires universitaires et des étudiants ayant les uns et les autres droit à un salaire. Il y a tout à gagner même à ouvrir de nouvelles alliances avec les salariés et les personnes en reprise d’études puisque la prochaine réforme de la formation professionnelle a vocation à les faire passer elles aussi pour des personnes qui consomment leurs études payantes et ne produisent pas en dehors de l’emploi.
Notes
[1] On présente parfois abusivement la loi comme l’introduction de la sélection à l’université comme si obtenir son baccalauréat ou un équivalent était donné à tout le monde et qu’il n’y avait pas déjà une forme de sélection. Elle est en réalité la fin du droit d’accès des bacheliers à l’université.
[2] Dans les années 1950, seulement 14% des parents ouvriers disaient envisager le baccalauréat pour leurs enfants. Aujourd’hui, les couches les plus défavorisées du salariat nourrissent quasiment les mêmes ambitions que les cadres pour leurs enfants, et sont 90% à voir dans le baccalauréat – et implicitement dans les études supérieures – un minimum non négociable. Sur ces chiffres et d’autres éléments sur les mobilisations scolaires des classes populaires, des jeunes femmes et des enfants d’immigrés qui en sont issus, voir Tristan Poullaouec, Le diplôme, arme des faibles. Les familles ouvrières et l’école, La Dispute, « L’enjeu scolaire », Paris, 2010.
[3] Ces messages doivent dans leur ensemble être pris avec beaucoup de prudence. Voir sur ce point Jérôme Hourdeaux, « Les Macronleaks posent plus de questions qu’ils ne font scandale », Médiapart, 11 mai 2017. Les extraits mobilisés par la suite sont tirées de la partie des échanges électroniques qui a été authentifiée par Wikileaks.
[4] Sur la plupart des éléments présentés dans ce texte, on pourra se reporter à Aurélien Casta, Un salaire étudiant. Financement et démocratisation des études, La Dispute, « Travail et salariat », Paris, 2017.
[5] Ici et dans la suite du texte, le terme de valeur ne renvoie pas au prix des études mais à leur valeur économique c’est-à-dire pour le dire simplement à la nature capitaliste ou non capitaliste des décisions prises en matière de financement de l’enseignement supérieur et de rémunération des personnes qui travaillent dans ce secteur. Le terme de valeur ne renvoie pas aux richesses ou aux valeurs d’usagemultiples – savoirs, savoir-faire mais aussi aspirations, participations politiques et liens sociaux de différentes natures – qui sont produites dans l’enseignement supérieur et la formation. Sur ce point, le conflit est beaucoup moins net puisque les deux camps ont pour habitude de défendre le rôle de l’enseignement supérieur dans la production de ce type de richesses.
[6] Cette représentation de l’étudiant est notamment inspirée de la théorie économique du capital humain.
[7] Jeunes passés par Science po ou HEC (école des hautes études commerciales de Paris), experts plus confirmés ayant dirigé d’autres écoles non universitaires, occupé des fonctions dirigeantes au sein des ministères éducatifs ou coopéré avec les groupes de réflexion Terra Nova (classé à gauche) et Institut Montaigne (à droite), les membres du groupe, surtout des hommes, ont en fait le même profil que l’entourage proche d’Emmanuel Macron. Sur ce point, voir François Denord et Paul Lagneau-Ymonet, « Les vieux habits de l’homme neuf », Le Monde diplomatique, mars 2017.
[8] De façon ponctuelle, les gouvernements ont octroyé des bourses ou des exonérations de frais d’inscription pour les étudiants les plus défavorisés. Ils ont aussi toujours permis que les diplômés les plus en difficulté puissent reporter le remboursement de leurs prêts. Ce remboursement ne peut toutefois être complètement annulé qu’au bout de 30 ans ou en cas de décès.
[9] Sur ces passages précis, on peut se reporter également à David Flacher et Hugo Harari-Kermadec, « La rentabilité de l’enseignement supérieur n’a aucun sens ! », Mensuel du Snesup, n°659, novembre 2017.
[10] Emmanuel Macron, Révolution, XO éditions, Paris, 2016, p. 114-115.
[11] Pour la formation continue, le projet est, on l’a vu, de développer ce mode d’études car les frais d’inscription sont librement fixés par les établissements. De façon plus générale, le projet d’Emmanuel Macron et de son entourage proche est de l’articuler à un compte personnel d’activité ou de formation. Ici, la valeur des études n’est pas produite dans le futur. Avec le compte, on suppose qu’elle a été produite dans le passé, qu’elle peut être épargnée et que les études peuvent être financées par un différé de la valeur créée dans les emplois précédents et épargnée dans un compte personnel.