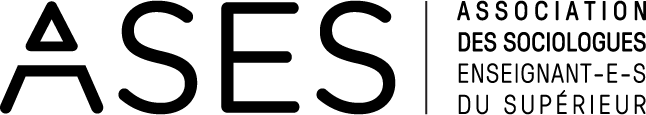«Les financements d’Etat ne suivent pas, le problème est là», JL Vayssière, président UVSQ
«Les financements d’Etat ne suivent pas, le problème est là»
Libération 9 juillet 2013
INTERVIEW Jean-Luc Vayssière est le président de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Par VÉRONIQUE SOULÉ
En février, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui accueille 20 000 étudiants, est arrivée en tête d’un classement officiel sur les établissements faisant le plus progresser leurs étudiants en licence. Aujourd’hui, son président, Jean-Luc Vayssière, se débat dans des problèmes financiers, avec un budget 2013 prévu en déficit et l’adoption d’un plan d’économies drastique. Il analyse pourLibération les causes de ces difficultés, communes à de nombreuses facs.
Quelle est la situation financière de votre université ?
Nous connaissons des difficultés comme la plupart des universités de l’académie de Versailles - apparemment seule Paris-X-Nanterre y échapperait. En 2012, nous avons enregistré un déficit de 5,2 millions d’euros. Et nous venons d’adopter un plan de retour à l’équilibre en 2016, avec un levier essentiel : la réduction de la masse salariale, qui portera essentiellement sur les emplois d’enseignants.
Où allez-vous couper ?
Nous allons réduire le volume des heures d’enseignement. Cela passe par vérifier que les masters aient un nombre suffisant d’étudiants. En licence, c’est plus compliqué : il est prévu au niveau national 1 500 heures d’enseignement au total par étudiant. Il n’est pas question d’y toucher. Nous allons donc jouer sur les options. Par exemple, vous avez une licence de maths ou de sociologie qui propose trois parcours pour 100 étudiants. Il n’y aura plus qu’un seul parcours. Comme on reproche aux licences d’être trop spécialisées, cela permettra d’y remédier. De plus, on préservera les TD en petits groupes. L’objectif est de réduire les heures de vacation ainsi que les heures complémentaires [les heures sup, ndlr], extrêmement nombreuses. Nous travaillons enfin à «geler» des emplois [créés sur le papier, ils ne sont pas attribués, les salaires prévus servant à combler les trous].
Comment en êtes-vous arrivé là ?
Nous sommes une université récente qui développe ses formations et sa recherche. Pour cela, nous investissons notamment dans l’immobilier. En septembre par exemple, nous avons ouvert une faculté de médecine. Comme cela s’est fait dans le cadre d’un partenariat public-privé [PPP, le projet public est confié à un constructeur privé qui perçoit un loyer ensuite pendant un certain temps, ndlr], nous devons payer un loyer de 750 000 euros par an. Il y a trois ans, nous avons aussi ouvert un bâtiment consacré aux sciences de l’environnement. Cela nous coûte 900 000 euros par an. Au total, nous nous retrouvons avec 4 millions de charges supplémentaires à la suite d’investissements et de travaux, que nous assumons seuls. Le problème est bien là : les financements d’Etat ne suivent pas. Cette année, nous avons ainsi eu un gel des dotations allouées par le ministère - 103 millions d’euros dont 91 millions pour les salaires et 12 millions pour le fonctionnement.
Vous avez tout de même eu des créations d’emplois dans le cadre des 1 000 postes promis chaque année dans le supérieur durant le quinquennat ?
Nous avons reçu 21 postes. Mais nous n’en recruterons que 6. Avec ce qui sera économisé, nous comblerons notre déficit. Surtout, cela nous permettra de garder nos contractuels. Je m’y suis engagé. En tant qu’université nouvelle, nous souffrons d’un manque d’enseignants - nous avons un millier de titulaires. Pour le surmonter, nous avons dû recruter de nombreux contractuels.
S’il fallait désigner une cause principale aux déficits qui se propagent ?
C’est le fameux GVT [le glissement vieillesse technicité, ou l’augmentation de la masse salariale du fait du vieillissement du personnel qui monte en échelon, ndlr] que l’Etat ne prend en charge que partiellement. Avec une moyenne d’âge de 40 à 45 ans, notre GVT nous coûte 500 000 euros par an.
Et vos responsabilités à vous ?
On a des améliorations à faire. Depuis que nous sommes passés à l’autonomie, en 2010, nous n’avons pas toujours utilisé les bons outils. Mais nous sommes responsables. Avec le soutien de toute la communauté universitaire, j’ai réagi et adopté un plan. A l’Etat aussi d’assumer sa volonté politique. Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’on nous a tendu une échelle pour que l’on grimpe, et qu’on nous la retire.