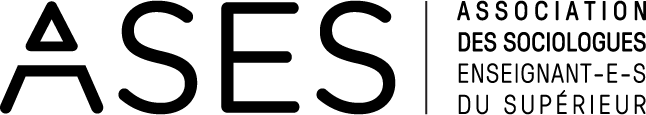Débat sur l'université entre François Vatin, Brice Le Gall, Sophie Orange et Romuald Bodin
Réponse à l'article de François Vatin "L’université française, ses perturbations et ses perturbateurs"->http://www.journaldumauss.net/spip.php?article953]
En lien avec ce sujet, l'interview de François Sarfati pour educpro : ["L’université peut être un lieu d’une très forte violence sociale"
De : Sophie ORANGE
Chers tous,
Comme Brice Le Gall et, sans doute, beaucoup d’autres encore, nous avons été surpris et gênés à la lecture des récents textes de François Vatin. Nous partageons certes sa critique d’une « privatisation rampante » de l’enseignement supérieur mais ni sa description de la situation de l’Université ni les solutions qu’ils proposent pour sortir cette dernière de ses difficultés – parfois, comme on le verra, plus supposées que réelles – ne sauraient nous convaincre.
1. Rompre avec une lecture duale de l’enseignement supérieur
Pour y voir plus clair, il faut d’abord commencer par rompre avec une lecture duale de l’enseignement supérieur français entre un secteur « sélectif » et un secteur « non sélectif ». Cette lecture binaire est un effet de mots. Elle n’est pas tenable lorsque l’on considère entre autres exemples le public des BTS – et on pourrait aussi évoquer nombre d’écoles spécialisées du travail social et du paramédical. En effet, comment comprendre que ces filières, assurant une sélection à leur entrée, soient les filières qui accueillent en plus grande proportion les minorités de l’enseignement supérieur que sont les bacheliers technologiques, les bacheliers professionnels et les bacheliers d’origine populaire ? Comment comprendre donc que les BTS, sections sélectives, accueillent des publics plus faibles scolairement que l’Université, non sélective ? Les chiffres là-dessus sont sans équivoque. En première année d’enseignement supérieur,
les taux de bacheliers professionnels tournent autour de 5 % en L1 (atteignant un maximum de 15 % en AES) quand les BTS accueillent un taux de 21,7 % de ces mêmes bacheliers. De même, les taux de bacheliers technologiques en première année d’Université (entre 10 et 15 % en moyenne, et jusqu’à 32,2 % en AES), sont toujours inférieurs à ceux des filières sélectives que sont les BTS (41,1 % pour le secteur tertiaire et 42,5 % pour le secteur secondaire) (Source : Repères et références statistiques Edition 2012, Ministère de l’Education nationale). Ce qui apparaît là est donc qu’on peut être à la fois une filière sélective et de
masse.
2. On choisit ce par quoi on est choisi
La sélection ne constitue donc pas une barrière magique qui place de fait les filières concernées du côté de l’élite et garantit l’excellence de
leurs publics. Dans le cas des BTS, pour reprendre cet exemple que nous connaissons bien, le travail des commissions de sélection ne consiste pas en un classement des candidats selon des critères académiques. La sélection à l’entrée des BTS est en effet ajustée à la position objective que ces filières occupent à la marge de l’enseignement supérieur : elle vise les candidats « moyens », que les autres filières n’attireront pas à elles. Ce ne sont donc pas des critères d’excellence qui président au recrutement : le numéro 1 de la liste n’est pas le plus brillant mais celui dont on est sûr qu’il ne préfèrera pas entrer en CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles), en IUT ou à l’Université (car oui, et par ailleurs, nombre d’étudiants viennent à l’Université par choix et non par défaut). Les étudiants sélectionnés sont alors bien souvent des bacheliers captifs, issus souvent du lycée-même, ne disposant pas des ressources économiques et sociales nécessaires au déplacement géographique vers une ville universitaire. La proximité est ainsi érigée comme un véritable critère de sélection dans de nombreuses commissions, tandis que les bons bacheliers généraux sont écartés. Le résultat de la sélection est donc intrinsèquement dépendant de la position occupée par la filière dans une hiérarchie fondée sur le prestige : c’est la place dans la hiérarchie symbolique des filières et des établissements qui définit la nature du public et non le caractère sélectif ou non d’une formation. La sélection ne viendrait donc pas métamorphoser les universités en filières d’élites : elle ne fera pas venir à elle des publics fortement dotés scolairement et socialement, du simple fait de l’existence de cette barrière à l’entrée. En bref, la barrière ne fera pas le niveau.
3.La démocratisation scolaire : le sale boulot de l’enseignement supérieur ?
Ainsi donc, déplore François Vatin, « l’Université publique est, en France, destinée à devenir l’enseignement supérieur des pauvres ». Or, contrairement à ce que dit François Vatin, il faut rappeler que ce « dirty work » de l’enseignement supérieur est loin d’être assuré par l’Université. Celle-ci parvient encore à se soulager de ses plus faibles étudiants avant même leur entrée dans le supérieur. En effet, bon nombre de bacheliers technologiques et professionnels n’envisagent même pas d’entrer à l’Université, ayant intériorisé l’idée que « la fac, ce n’est pas pour eux ». Ils ne sont d’ailleurs pas si nombreux que cela à y entrer. Ce n’est en effet qu’un peu plus d’un quart des diplômés d’un baccalauréat professionnel qui entrent dans l’enseignement supérieur (28,5 %), contre 77 % des diplômés d’un baccalauréat technologique et 98,7 % d’un baccalauréat général. Ensuite, les deux tiers de ces bacheliers professionnels s’inscrivent en BTS (66,0 %) contre seulement 27,4 % à l’Université. De même, les flux des bacheliers technologiques se concentrent sur les BTS (54,5 %, contre 23,2 % à l’Université et 12,5 % en IUT). Dans le même temps, c’est plus d’un bachelier général sur deux (52,8 %) qui entrent à l’Université, contre 10,8 % en IUT et 8,8 % en BTS. Il faut également rappeler, au-delà de ces écarts de taux, que les volumes d’étudiants concernés diffèrent fortement. Ainsi, à la rentrée 2011, ce sont 280 254 bacheliers généraux qui sont entrés directement dans l’enseignement supérieur, contre 99 654 bacheliers technologiques et
seulement 44 438 bacheliers professionnels. Contre les discours de diabolisation de ces « bacheliers en situation irrégulière », il faut donc bien avoir à l’esprit que ces étudiants sont marginaux à double titre : du point de vue de la figure originelle de l’étudiant, mais aussi et surtout du point de vue de leur nombre (Source : Repères et références statistiques Edition 2012, Ministère de l’Education nationale). Ce qui fait qu’à la rentrée 2011, l’Université a accueilli 147 794 bacheliers généraux fraîchement diplômés, contre seulement 12 099 bacheliers professionnels. On est donc très loin d’un quelconque envahissement.
La fameuse analyse de Raymond Boudon sur l’échec des filières courtes est donc quelque peu datée. Au moment-même où il rédigeait le constat d’une incapacité des IUT à absorber les flux des « nouveaux étudiants », les BTS
voyaient leurs effectifs augmenter fortement et surtout, leur public se distinguer durablement de celui de leur « faux-jumeau » IUT. Entre le début des années 1970 et aujourd’hui, le taux d’enfants d’ouvriers en BTS est passé de 19,1 % à 30,5 % tandis qu’il passait de 23,7 % à 18,6 % en IUT. Et c’est justement en puisant fortement dans la nouvelle population
disponible scolarisable que constituaient les nouveaux bacheliers technologiques et les nouveaux bacheliers professionnels que les BTS ont connu leur croissance exponentielle et ont réussi à s’imposer comme élément central du paysage de l’enseignement supérieur français. Ainsi, à l’heure actuelle, un bachelier sur cinq ne constitue ses vœux d’orientation post-bac que dans un espace limité aux seuls BTS (Source : SAIO de Poitiers). Ces filières-là viennent donc moins piller l’Université de ses meilleurs éléments qu’elles ne la soulagent des plus faibles scolairement, en s’adressent d’abord aux abstentionnistes de l’enseignement supérieur, i.e. ceux qui n’auraient pas poursuivi leurs études autrement. Il est donc difficile de parler d’une concurrence entre ces filières. Par ailleurs, la thèse du contournement du premier cycle universitaire par le passage dans une filière sélective peut être fortement contestée lorsque l’on connaît le devenir des diplômés d’un BTS : un tiers continue effectivement son cursus (mais parfois au prix d’une relégation en première année d’Université), un tiers aurait souhaité poursuivre mais n’est finalement pas admis dans la filière de son choix, et un dernier tiers n’a pas désiré prolonger ses études.
4. Régulation ou « harmonie préétablie » ?
Pour finir, l’analyse de François Vatin nous semble tout à fait paradoxale. Elle nous apparaît moins comme une « mise en évidence d’effets pervers », selon ses propres termes, que comme une prise de position biaisée et contreproductive au regard même des objectifs qu’elle se donne. Le discours sur la « crise » de l’Université, sur les taux d’abandon et/ou d’échecs catastrophiques en première année de licence, ou encore sur une Université « usine à chômeurs » auquel se prête François Vatin, est justement celui-là même qui justifient chez d’autres la privatisation de l’enseignement supérieur à laquelle il s’oppose. Plus encore, ce discours crisologique et tout en « négatif » est le produit d’une construction sociale et politique qui nourrie et justifie depuis de nombreuses années maintenant les réformes de l’Université publique et le projet de sa privatisation au moins partielle.
Nous n’ignorons pas (ne serait-ce que pour le vivre nous-mêmes) les difficultés quotidiennes de l’enseignement à l’Université, inséparables de conditions de travail dégradées, mais nous ne saurions participer à la myopie contemporaine qui tend à ignorer et le caractère très ancien des taux élevés d’abandon en première année et la nature véritable de ces derniers.
Etant donnée sa position intermédiaire (entre les filières courtes et/ou moins exigeantes scolairement) et les filières d’élites (pas seulement scolaires), ainsi que son caractère « ouvert » (plutôt que non sélectif), l’Université tend à jouer le rôle d’espace de régulation via ces premiers cycles. La première année de licence contribue en effet à réajuster, et/ou à redistribuer dans les différentes filières, les étudiants qui ont le tort aujourd’hui de ne pas avoir une trajectoire parfaitement linéaire et pré-ajustée, dans une sorte d’harmonie préétablie. Contre le discours institutionnel, il faut rappeler que derrière le « taux d’échec considérable » se cachent des situations particulièrement hétérogènes. Une fois cela pris en compte, parler d'« échec » a-t-il seulement un sens ? Par exemple, pour de nombreux étudiants disparus en année n+2, l’inscription dans un premier cycle universitaire constitue une propédeutique à des formations futures hors université au sein desquelles ils n’auraient sans doute pu « s’épanouir » autrement. C’est le cas d’étudiants qui, le plus souvent inscrits en sciences du vivant, en psychologie ou en sociologie, usent de ces disciplines pour accéder à des écoles spécialisées, généralement dans le social ou le paramédical. Pour ces étudiants, l’Université fait alors fonction d’école préparatoire. Ils s’inscrivent en faculté avec le projet d’entrer le plus rapidement possible dans une école mais ont le sentiment de devoir encore se préparer au concours qui en sanctionne l’entrée en améliorant leurs connaissances dans telle ou telle discipline ou, plus simplement, comme c’est souvent le cas pour les écoles de travailleurs sociaux, en attendant de vieillir de quelques années pour paraître et se sentir plus « matures ». D'une certaine façon, ces étudiants détournent l’offre universitaire. Ils se l’approprient comme un lieu de préparation de leur avenir professionnel où l’obtention d’un diplôme n’est pas une priorité. En ce sens, l’Université joue son rôle, fut-ce malgré elle, d’encadrement, de formation et d’accompagnement des nouveaux bacheliers vers un avenir professionnel.
De ce point de vue, parler sans plus de précautions de l'« échec dans les premiers cycles universitaires », c'est s'interdire par avance de saisir la réalité de ce qui se joue dans ces premiers cycles. Pour prendre un exemple plus concret, lorsque l'université de Poitiers annonce, pour 2006-2007, « 47 % d'échec au terme de la première année », non seulement on note que redoublements et non-réinscriptions sont regroupés dans une même catégorie mais plus encore une analyse sommaire des chiffres fournis permet de constater que la non réinscription est loin de correspondre à l'idée que l'on se fait généralement de l'« abandon ». Une année après leur non réinscription, en effet, 62% des étudiants « décrocheurs » sont encore en formation (32% sont inscrits en STS, 27% dans une école spécialisée -écoles d'infirmières, du travail social, para-médicales, d'arts appliqués, de journalisme, etc.-, 19% en licence dans une autre université, 7% en préparation d'un concours, 5% en IUT, etc.) et 27% sont en emploi. En d'autres termes, seul 11% des étudiants considérés en « abandon », soit 7% des étudiants considérés en « échec », ou encore 3,5% des étudiants inscrits en première année, se sont retrouvés au terme de cette année là, sans formation et/ou sans emploi. A contrario, la très grande majorité a changé de voie, réussi un concours ou trouvé un emploi.
S’il ne s’agit donc pas de nier les difficultés que rencontrent un nombre important d'étudiants en première année de licence, il faut toutefois souligner que les glissements interprétatifs qui accompagnent généralement les commentaires de ce phénomène en termes d’« échec », comme le caractère alarmiste des lectures auxquelles il donne lieu, font écran à une véritable compréhension du phénomène de « l'abandon ».
Il semble alors que l’on s’inquiète aujourd’hui d’autant plus de ces parcours non linéaires que ces tâtonnements et ces essais sont désormais le fait d’étudiants peu dotés scolairement et socialement ; tandis que dans les années 1960 – où le problème de l’orientation et de l’abandon en 1ère année était déjà d’actualité – ces erreurs étaient associées à « la bohème » inhérente au statut d’étudiant. Tout comme on s’alarme désormais du manque de projets professionnels de ces nouveaux étudiants, alors qu’on ne demande en aucun cas aux étudiants des classes préparatoires ni des grandes écoles ce qu’ils veulent faire plus tard (et en l’occurrence ils n’en savent souvent rien).
Pour toutes ces raisons, la sélection nous apparaît comme une fausse solution à un problème mal posé. Plus encore, le risque d’une telle sélection serait d’accentuer davantage la segmentation de l’enseignement supérieur en attribuant des « places naturelles » à des publics spécifiques. C’est notamment toute la direction prise par les réflexions des gouvernements précédents sur l’enseignement supérieur, qui visent à restreindre les STS et les IUT à un rôle d’accueil des reflux universitaires (cf. le récent rapport du sénateur Demuynck). Ce qui viendrait dès lors institutionnaliser un enseignement supérieur à deux vitesses : un « petit supérieur » pour les moins dotés scolairement et socialement, et un supérieur long pour les plus favorisés – figeant plus encore l’alignement des hiérarchies sociales sur la hiérarchie des filières et des disciplines. Face à cela, c’est bien plutôt à la revalorisation de l’Université qu’il faudrait s’atteler. D’une part, en rappelant (martelant) la qualité avérée de son enseignement – et ce, parfois, contre la représentation que les universitaires s’en font eux-mêmes -, d’autre part en travaillant à l’amélioration des conditions de travail pour l’ensemble des étudiants et des personnels. Ce dont l’Université publique a besoin, c’est donc d’une politique ambitieuse, qui ne pourra se passer de rediscuter l’organisation de l’enseignement supérieur et les effets structurels qui en découlent, mais qui visera aussi à réinjecter des moyens de manière pérenne. La solution se trouve moins du côté du tri des étudiants que du côté des conditions de possibilités matérielles et symboliques d’une démocratisation, toujours promise mais jamais réellement réalisée.
Sophie Orange (Maître de conférences en sociologie, université de Nantes) et Romuald Bodin (Maître de conférences en sociologie, université de Poitiers)