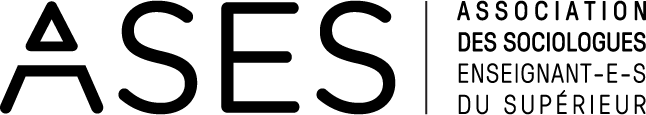Des enseignants contestent toujours la réforme de l’université (Faïza Zerouala - Médiapart)
Parcoursup, la nouvelle plateforme d'orientation post-bac, est entrée en service. Alors que la loi n'est pas officiellement adoptée, des enseignants-chercheurs combattent toujours une réforme qui va, selon eux, fragiliser les plus faibles. Un appel à la grève est lancé pour le 1er février.
Au pied de la tribune, une affiche dépeint un Emmanuel Macron plaqué sur le corps d’une Marie-Antoinette dédaigneuse. Le président-roi rebaptisé Macron-Antoinette s’exclame : « S’ils ne sont pas admis à l’université, qu’ils créent une start-up. »
Une autre pancarte désigne la sélection comme « un piège à cons » pastichant le slogan de Mai-68. Le ton est donné, ce samedi 20 janvier, où l’Association des sociologues enseignants du supérieur, l’ASES, organisait une assemblée générale à la Bourse du travail de Paris, à deux pas de la place de la République.
Trois cents participants ont affûté leurs arguments pour s’opposer à la réforme en cours de l’université menée par le gouvernement et essayer de tracer un plan de bataille. La salle est comble, l’atmosphère studieuse, les prises de parole précises et tranchantes. Certains dans l’auditoire prennent des notes, ordinateur sur les genoux.
Un large arc du paysage universitaire est présent. Des enseignants, des chercheurs qui ont travaillé et publié des ouvrages sur l’université, des syndicalistes de l’enseignement supérieur et du secondaire venus unir leur force contre cette réforme mais aussi contre celle du baccalauréat et du lycée. L’enjeu étant de réussir à allumer la flamme d’une mobilisation contre la sélection introduite par cette loi. Le gouvernement a beau multiplier les dénégations, la réalité démontre le contraire.
Le texte du projet de loi formule noir sur blanc ces nouvelles exigences : « Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, explique le projet de loi, les inscriptions sont prononcées (…) dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. »
![]() Au meeting de la Bourse du travail © FZ
Au meeting de la Bourse du travail © FZ
La date de la réunion n’a pas été choisie au hasard, la nouvelle plateforme d’accès à l’enseignement supérieur entre en service ce lundi 22 janvier, après une semaine de mise en ligne purement informative. Hasard du calendrier, Alain Devaquet, le ministre dont le nom restera associé à la réforme avortée de l’université en 1986, est décédé le 21 janvier alors que, peu ou prou, les mêmes débats traversent la société.
Lire le billet de l’historien de l’éducation Claude Lelièvre
Parcoursup, qui succède donc au décrié APB, doit permettre de mieux orienter les 800 000 futurs étudiants pour, dit le gouvernement, empêcher l’échec massif en première année et éviter l’injuste tirage au sort, utilisé en 2016 pour 3 500 bacheliers sur 600 000 néo-bacheliers. La pratique est restée marginale, mais son existence a été instrumentalisée par la ministre de l’enseignement supérieur et la majorité présidentielle pour justifier l’urgence de tout bouleverser au pas de charge.
Le dispositif prévu dans le projet de loi Orientation et réussite des étudiants a été adopté en première lecture à l’assemblée nationale un peu avant Noël. Seulement, le texte est censé passer début février entre les mains des sénateurs, puis devant une commission mixte paritaire avant de revenir au Palais-Bourbon. Bref, la navette parlementaire n’est pas encore achevée. Seulement, le gouvernement fait comme si tout était déjà entériné et a déjà enclenché la réforme au mépris de la loi… Le code de l’éducation et son article L. 612-3 qui dispose que toute personne titulaire du baccalauréat est « libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix » n’a pas encore été modifié par exemple. « Tous les actes qui seront votés par les universités dans le cadre d’une loi qui n’a pas été adoptée, nous les attaquerons en justice », a prévenu le sénateur PCF des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias, invitant les enseignants-chercheurs à aller au tribunal administratif à chaque fois. Il souhaite ainsi contrer « la dérive autoritaire de ce pouvoir ».
Il faut dire que l'exécutif n’a pas croisé sur sa route de vives protestations. La sociologue Annabelle Allouch rappelle que certains professeurs et élèves adhèrent à cette mesure, par lassitude. La chercheuse Anne-Cécile Douillet interprète le peu d’entrain de certains à entrer dans la lutte comme du pragmatisme pur : « La résistance est difficile à mener car les départements des universités sont en train de négocier les quelques moyens supplémentaires que nous avons. Pour avoir un poste là où il en faudrait quinze. »
Les présidents d’université sont pour leur part majoritairement favorables à une réforme qui va leur permettre d’accueillir les meilleurs éléments et ainsi revaloriser les cursus, l’université étant toujours considérée comme le parent pauvre de l’excellence française ou une voie par défaut, à tort.
Du côté des étudiants, volontiers remuants d’habitude, c’est le calme plat. L’organisation majoritaire, la Fage, soutient la réforme même si elle jure rester « vigilante » face à son application. L’Unef, devenue seconde force universitaire, est atone et semble crier dans le désert son opposition à une « sélection qui ne dit pas son nom ». L’air de rien, le gouvernement a poursuivi, ce week-end, son œuvre de pédagogie et a continué, sur les réseaux sociaux notamment, de diffuser ses éléments de langage. À l’instar du porte-parole d’En Marche!, le député Gabriel Attal, par ailleurs rapporteur du texte de loi, qui a publié une vidéo sur le sujet sur Twitter.
Les étudiants ont donc jusqu’au 13 mars pour formuler dix vœux d’orientation, sans aucune hiérarchie entre eux. Pour les aider à faire leur choix, une somme « d’attendus », c’est-à-dire les connaissances et compétences requises pour prétendre à telle ou telle formation, est édictée. Et c’est bien ce qui fait débat parmi la communauté universitaire, censée établir des attendus locaux propres aux spécificités des formations, qui se superposeront ou compléteront les attendus nationaux, plus généraux devant garantir l’égalité des diplômes. La liste de compétences a été publiée et les prérequis restent très flous. Le cas échéant, ceux-ci s’appliqueront si les établissements refusent de jouer le jeu.
En effet, les réfractaires à cette méthode de tri dans une vingtaine d’universités ont décidé, avant les vacances de Noël, de ne pas faire remonter ces fameux attendus et de voter des motions contre son instauration. Pascal Maillard, de l’université de Strasbourg et du Snesup, le syndicat majoritaire, a trouvé une solution : « Nous avons intégré l’obéissance à l’université, devenue une pyramide de la servitude volontaire. C’est une pyramide que nous devons briser. » Il faut dire que depuis l’échec de la mobilisation contre la loi Pécresse, les universitaires sont bien plus frileux pour aller dans la rue. Pour ce faire, il incite ses homologues à ne pas appliquer la loi dans un élan de « désobéissance éthique et civile ».
(Lire le billet de Pascal Maillard ici)
Des universitaires expliquent qu’ils protestent contre la philosophie de la réforme mais aussi contre son application concrète, précipitée au possible et génératrice d’un surcroît de travail administratif qu’il leur est impossible d’absorber. Lors du meeting à la Bourse du travail, une intervenante a rappelé à quel point les personnels d’université sont en proie à une réelle souffrance au travail. Et ce ne sont pas les 6 millions d’euros débloqués par le ministère pour y faire face et aussi mettre un peu d’émollient dans ses relations avec les universités qui vont y changer quelque chose. Une intervenante alerte sur la possibilité « d’un plantage technique » du site, qu’il faudra dénoncer le cas échéant.
Les enseignants-chercheurs et syndicalistes de la Bourse du travail ont voulu démontrer au gouvernement qu’ils ne sont pas dupes, mais prêts à se révolter contre une future loi qui va dessiner un tout nouveau visage à l’université publique.
Ainsi, pléthore d’interventions ont-elles rappelé les fondamentaux qui irriguent l’université et lui donnent sa mission. Il a été question d’idéal républicain, d’égalité des chances, de démocratisation de l’enseignement scolaire ou encore de la crainte de l’instauration d’une université à double vitesse. Autant d’acquis à préserver, selon les enseignants-chercheurs réunis.
Plus d’autocensure pour les élèves
À la rentrée, Emmanuel Macron avait touché à un symbole fort en déclarant dans un entretien : « Nous ferons en sorte que l’on arrête, par exemple, de faire croire à tout le monde que l’université est la solution pour tout le monde. » Il assumait vouloir donner un coup d’arrêt à la démocratisation des études supérieures. Il s’attaquait ainsi à un principe fondateur de l’université, accessible à toutes et tous, sur la seule base d’avoir un baccalauréat, quelle que soit sa série ou sa filière.
![]() Les universitaires réunis à la Bourse du travail © DR
Les universitaires réunis à la Bourse du travail © DR
Cette phrase n’a pas été oubliée à la Bourse du travail, où tout au long de l’après-midi, les orateurs et oratrices se sont livrés à une dissection précise de la loi, au-delà du seul aspect « technique » souvent mis en avant par le gouvernement.
Romain Pudal, de l’ASES, a ainsi expliqué à l’adresse du gouvernement et des architectes de cette réforme qu’elle « ne touchera pas leurs enfants. Les autres auront des jobs mal payés. C’est un choix politique et de société. Il n’y aura plus de mobilité sociale alors que la démocratisation scolaire n’est pas un gros mot ». Il a ensuite précisé que l’université n’était pas la solution idoine pour tous, qu’il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un doctorat pour réussir, mais il aimerait que la chance et la possibilité en demeurent ouvertes.
Bien sûr, ont été évoqués les maux de l’université comme sa paupérisation, les multiples réformes qui l’ont touchée comme la loi d’autonomie de 2008 ou encore l’incapacité matérielle qui l’empêche d’accueillir et d’encadrer dans de bonnes conditions les 40 000 étudiants supplémentaires prévus en 2018. Là, où il faudrait créer des places, le gouvernement préfère trier ceux qui pourront intégrer ces facultés, sur la base de critères plus ou moins discutables.
[[lire_aussi]]Stéphane Bonnery, professeur en science de l’éducation à Paris-8, a dénoncé un « profilage des filières » avec une hiérarchisation croissante. Il a raconté à la tribune comment le président de son université a promis un poste de maître de conférences si 17 étudiants supplémentaires étaient accueillis dans son département. Romuald Bodin, maître de conférences en sociologie à l’université de Poitiers, et auteur, avec Sophie Orange, de L’Université n’est pas en crise, a expliqué comment la sélection, même si le mot est soigneusement évité par la ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal, n’évitait pas l’échec scolaire et ne permettait donc pas de rehausser le niveau dans les filières. Résultat : les plus fragiles, c’est-à-dire les bacs professionnels, les étudiants en réorientation, ceux qui se sont trompés de voie, les enfants d’ouvriers se verront barrer la route de l’université. « Elle élimine d’abord, et mécaniquement, les profils plus atypiques, y compris les plus solides », selon le sociologue. Pour lui, cette réforme ne va permettre que de renforcer « l’esprit de corps » et donner « aux sélectionnés le sentiment d’élection », donc renforcer « la distinction et les inégalités » dans le supérieur.
Corine Eyraud, maître de conférences en sociologie à l’université d’Aix-Marseille, a choisi d’axer son intervention sur les modalités pratiques de la réforme. De fait, avec la disparition de la hiérarchie des vœux, les universités vont devoir tous les examiner, là où ils se contentaient de regarder le premier, voire le second en cas de refus du choix de tête de liste. La capacité d’accueil de sa filière est de 250 places : « Nous aurons entre 200 et 2 000 vœux à examiner pour la sociologie à Marseille. Or, dès que la capacité d’accueil est atteinte, ParcourSup place automatiquement le 251e en attente. D’où la nécessité d’un classement, même pour les filières qui peuvent accueillir toutes les demandes. » À ses yeux, il est impossible de « faire qualitativement ce traitement ».
L’autocensure induite par les attendus est aussi mise à l’index. Dans les filières en tension, les plus prisées, il y aura de fait classement et sélection, explique encore Corine Eyraud. Pour elle, « il s’agit rendre plus précoces les choix structurants, voire bloquants. Parfois, dès la seconde, on demande pour la sociologie une discipline scientifique, de celles qui ne figurent pas, sauf anticipation, dans les bac L. Les attendus ne peuvent qu’avoir un fort effet de découragement. » Anne-Cécile Douillet, professeur d’université de Sciences Po Lille, abonde dans son sens. Elle considère que certains critères sont fort discriminants car le parcours scolaire aura désormais un poids déterminant dans l’accès à l’université. Les activités extra-scolaires, la pratique d’une langue vivante supplémentaire ou la possession du BAFA entreront aussi en ligne de compte, révélant un peu plus les fractures sociales. Dans les milieux défavorisés, là où les familles maîtrisent le moins les codes et les stratégies scolaires, les élèves auront encore moins de chance de réussir à dépasser ces obstacles sélectifs.
Annabelle Allouch, maître de conférences en sociologie à l’université d’Amiens et auteure de La Société du concours, poursuit sur les perdants de la sélection. Elle prend pour points de comparaison les cas anglo-saxons en tête des classements internationaux qui « fabriquent une sorte de monde hiérarchisé ». Pour la sociologue, ce modèle a un coût social fort. Les montants des frais d’inscription se sont affolés par exemple. Les exigences scolaires aussi. Les minorités ethniques, souvent issues des milieux les plus modestes, n’y ont plus trouvé leur place. « Même pour les Anglo-Saxons, la sélection ne fait pas ses preuves et n’est pas une évidence », conclut-elle.
Jean-Louis Fournel, professeur à Paris-8 et cofondateur de Sauvons l’université, association qui avait porté la contestation contre la loi Pécresse en 2008-2009, est révolté contre ce qu’il qualifie de ségrégation, entre les élèves, mais aussi entre « une université pour les riches et l’autre pour les pauvres ». Il appelle à se battre contre ce projet de société même s'il n'a pas de solution efficace et immédiate pour transformer ce désir en réalité : « On a deux mois pour le faire. On a entrebâillé la porte, on a mis un pied dedans, il faut l’ouvrir maintenant. Je ne sais pas comment… », avoue-t-il, déclenchant les rires de l’assemblée. Un premier geste sera le vote à l’unanimité, à l’issue de l’assemblée générale, d’un appel pour le retrait de la loi.