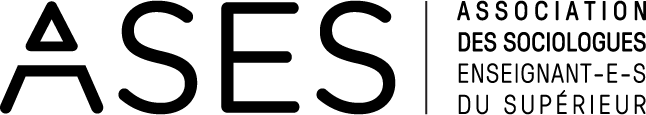Grand entretien - Quelques aspects de la gestion néo-libérale dans le système universitaire anglo-saxon
Entretien avec Jean Jacques Courtine*, Professor in European Studies, University of Auckland, réalisé en novembre 2014, à la Fondation Suger par Christel Coton et Romain Pudal, revu par Christel Coton et Jean-Jacques Courtine.
Les universités nord-américaines, parfois présentées comme un eldorado par les médias et parfois même par des collègues en visite outre-Atlantique, nous semblent constituer un système extrêmement inégalitaire, dont seule une minorité très privilégiée bénéficiant d’importants financements privés profiterait avec plus ou moins d’aisance. Les signes d’une « néo-libéralisation à l’américaine » du système européen invitent à interroger les dessous de ce rêve universitaire américain. Christel Coton et Romain Pudal ont pu rencontrer Jean-Jacques Courtine, dont la connaissance fine des universités françaises et étasuniennes, éclaire le débat.
* Jean-Jacques Courtine est Professeur d’études européennes à l’Université d’Auckland (Nouvelle-Zélande), professeur émérite à l’Université de Californie à Santa Barbara et à Paris Sorbonne Nouvelle. Linguiste de formation, il enseigne l’histoire et l’anthropologie
culturelles. Parmi ses travaux récents : Histoire du corps, XVIe-XXe siècle (3 vol., Seuil,
2005-2006) et Histoire de la virilité, de l’Antiquité au XXIe siècle (3 vol., Seuil, 2011), qu’il a codirigées avec Alain Corbin et Georges Vigarello. Également : Déchiffrer le corps. Penser avec Foucault (Jérôme Millon, 2011). Il travaille actuellement à une histoire culturelle de l’anxiété.
Le modèle américain est très souvent mobilisé en France pour justifier les réformes dans lesquelles sont engagés l’Enseignement Supérieur et la Recherche. Notre connaissance de ce modèle est pourtant très parcellaire. Vous avez eu l’occasion de circuler dans de nombreuses institutions universitaires anglophones (que ce soit aux États-Unis ou en Nouvelle Zélande). Pourriez-vous nous éclairer, dans un premier temps, sur les différences qui
peuvent exister entre le secteur public et le secteur privé dans l’enseignement supérieur américain ?
J’ai eu l’occasion de travailler aux États-Unis une quinzaine d’années, du milieu des années 1980 au début des années 2000, à la fois dans des universités d’État et dans des universités privées. Si on considère notamment la question du financement des universités publiques et privées, la distinction est loin d’être aussi nette que celle que l’on peut observer en France. La part des financements « publics » par l’État de l’Université de Californie à Santa Barbara, où j’ai enseigné, s’élève ainsi à environ 20% du budget total de l’établissement. Il s’agit pourtant d’une université publique, l’université de l’État de Californie. Les budgets sont largement alimentés par des ressources extérieures et des sources privées, même dans les universités publiques. En ce qui concerne les universités privées, les financements sont bien évidemment essentiellement privés. Les plus importantes sont des établissements aux budgets astronomiques. Les fonds sont le plus souvent en provenance de l’industrie, des contrats, des dons, des fondations, des alumni, c’est-à-dire des anciens élèves. J’ai enseigné jadis également à USC (University of Southern California), grosse université privée à Los Angeles. Elle possède la plus importante école de cinéma des États-Unis – on est à Hollywood... – et compte donc, parmi ses donateurs récurrents, des personnalités comme George Lucas. On imagine le cash flow... Ces établissements ont ainsi des ressources financières sans comparaison avec ce que l’on peut connaître en France ou en Europe. Les entreprises bénéficient par ailleurs d’avantages fiscaux importants quand elles financent des institutions d’enseignement ou de recherche. La tradition du mécénat dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis en particulier est extrêmement développée. Et les porosités bien plus grandes entre les deux secteurs. Et ce qui est vrai des financements l’est aussi des fonctions. A Auckland, en Nouvelle Zélande, où j’enseigne actuellement, notre Vice Chancelor (l’équivalent de nos présidents d’université en France) vient du secteur privé. Ce n’est pas systématiquement le cas aux États-Unis : les « présidents d’université » sont le plus souvent engagés dans des carrières administratives
professionnalisées, mais ils viennent généralement du corps des universitaires.
Est-ce que la recherche de financements privés a des conséquences sur le travail des enseignants-chercheurs ? Est-ce qu’elle est intégrée dans les « tâches » qui définissent le service de l’enseignant ?
C’est un horizon inquiétant. Dans les départements de « sciences dures », la recherche d’argent est devenue une véritable routine, et entraîne une nouvelle forme de division du travail. À tel point que, dans l’université de Californie, on pouvait distinguer, lorsque j’y travaillais, deux types de carrière scientifique dans les départements de Physique et de Chimie, et j’imagine que cela doit toujours être le cas. Les prix Nobel présents sur le campus ne font bien évidemment que de la recherche, cependant que d’autres enseignants-chercheurs ne font pratiquement que de la recherche de subventions. C’est une manière pragmatique de régler un problème qui tend à se poser partout, dans les sciences humaines également : devoir passer autant de temps, sinon plus de temps, à écrire des rapports ou des projets pour obtenir des subventions qu’à faire de la recherche. La plupart des enseignants-chercheurs ont dorénavant intégré ça dans leur emploi du temps. Moi qui fais partie d’une autre génération, j’avoue trouver l’exercice extrêmement coûteux. Quand j’ai commencé ma carrière universitaire, tout d’abord, je n’avais pas le sentiment d’avoir besoin d’argent. Oui, j’avais besoin d’un salaire, décent autant que possible, de me poser à la Bibliothèque Nationale, d’avoir des bouquins et de quoi écrire ! Aujourd’hui, dans le monde universitaire où je travaille, on a l’impression qu’on ne peut plus rien faire, le sentiment de ne pas exister si on n’a pas obtenu une manne financière conséquente. Que le fonctionnement des différents services de l’université puisse s’appuyer sur ces volumes de financements extérieurs, et que l’administration le souhaite, c’est une chose. Mais le chercheur lui-même ?... Avons-nous véritablement besoin de cela ?... La question se pose d’autant plus que d’après une rumeur insistante, là où j’enseigne, dans un établissement en voie de transformation néolibérale accélérée, il est question d’intégrer aux critères de promotion des seuils de financements extérieurs qu’il appartiendrait aux chercheurs d’atteindre. Ce modèle, venu de l’entreprise privée, serait, s’il lui arrivait d’être appliqué dans les sciences humaines, une catastrophe pour celles-ci.
Est-ce que ces contributeurs privés obtiennent en contrepartie une place dans les conseils d’administration de ces établissements ? Interviennent-ils sur le contenu des formations ?
Il y a une présence de l’industrie, du commerce, des affaires locales, oui. Cette présence n’est pas forcément décisive, mais elle existe. On ne peut pas dire cependant qu’elle intervienne directement dans la définition du contenu des formations. Dans la majorité des cas, les universités gardent la maîtrise de leur destin. En réalité, le problème, ce n’est pas tant la présence d’intérêts privés que le modèle entrepreneurial dans lequel se sont glissées les universités. Qu’elles soient publiques ou privées, elles définissent de plus en plus nettement leur devenir dans les cadres et les termes même du modèle de l’entreprise privée. On ne voit ainsi plus très bien où se situe la différence entre le secteur public et le secteur privé. C’est ce que raconte Lindsay Waters dans l’ouvrage que j’ai traduit en 2008[1] : les universités américaines sont, depuis la Seconde Guerre mondiale, engagées dans la
reproduction du modèle de l’entreprise privée. Elles conservent encore quelques anachronismes comme l’existence des humanities (c’est-à-dire des secteurs non rentables de l’université) ou la tenure[2], mais tout travaille à les menacer.
Pour les Humanités, la situation est paradoxale : plus les universités sont riches, plus elles sont prestigieuses et plus elles sont en mesure de maintenir des « façades » où les sciences humaines sont présentes. Pour jouer dans la « cour des grands », il est important d’avoir une vitrine dans laquelle on intègre du français, de la philosophie, des études classiques ou théâtrales... Dans les universités dont la réputation est moins établie et où la situation est plus délicate sur le plan financier, ce sont ces disciplines moins rentables qui font les premières l’expérience des coupes budgétaires[3]. Lors de la crise des années 1990 aux États-Unis, je vivais à Los Angeles et j’ai vu pas mal de restaurants français fermer les uns après les autres. Pourquoi ? Parce que ces dépenses étaient jugées secondaires en temps de crise. Les départements de Drama, Classics, French, etc. sont un peu comme la gastronomie française, superflus en période de restriction. Aux États-Unis, les universités qui souffrent le plus, qui peinent à maintenir ce qui existe, ce sont certaines universités d’État dont le prestige est moins grand dans l’échelle des hiérarchies « universitaires »[4] qui s’est mise en place. Si vous me demandez s’il existera encore un département de Français ou d’études classiques à Yale dans vingt ans, je vous dirai oui, sans aucun doute. Est-ce que ce sera le cas dans une bonne université publique du centre des États-Unis, par exemple l’université d’État du Nebraska ?... Je dirai que c’est bien moins sûr. Et dans ce qu’on appelle les community colleges, qui sont les plus petits établissements universitaires locaux, qui dépendent des villes, je pense qu’il risque bien de ne plus y avoir d’enseignement du français du tout.
L’autre « anachronisme » dans un système universitaire néolibéral est la tenure. La tenure est un terme médiéval qui désignait l’exploitation en propre d’un lopin de terre qui appartenait au seigneur mais dont les produits revenaient à l’exploitant. La tenure assure la sécurité de l’emploi aux professeurs des universités. Ce statut de protection de l’emploi fait l’objet d’attaques régulières dans la presse américaine, un peu à la manière dont le statut de la fonction publique est périodiquement remis en question en France. Et parallèlement, les Humanités et les Sciences Sociales, surtout quand elles ne visent pas d’applications immédiates ou des recherches de brevets, voient leur utilité mise en doute...
Et pourtant, les Humanités et la sécurité de l’emploi font bien évidemment
étaient sur une tenure track, engagés dans la voie de la sécurité de l’emploi. Ils devenaient ensuite Associate Professor, et étaient titularisés. Ils publiaient alors un livre ou deux pour devenir Full Professor. La carrière se faisait comme ça. Dans toutes les universités, c’est ce modèle qui s’appliquait. Maintenant, les administrations universitaires essayent d’avoir de moins en moins de personnels titulaires et de plus en plus de gens dont elles peuvent se débarrasser en fonction des fluctuations du marché: s’il y a plus ou moins d’étudiants, plus ou moins d’argent. À l’université d’Auckland aujourd’hui, on se plaint du nombre trop élevé de titulaires. L’idéal serait un ratio 80/20 : 80% de sécurité d’emploi, 20% de personnes «taillables et corvéables à merci». Cette règle tend à s’étendre. Aux États-Unis, si on regarde les postes publiés dans The Chronicle of Higher Education ou dans la liste annuelle du MLA (Modern Language Association), on s’aperçoit qu’il y a de moins en moins de tenure tracks. On recrute de plus en plus des adjuncts. Et là, c’est une autre affaire! Il s’agit de non titulaires, payés à la pièce et privés le plus souvent de benefits, c’est-à-dire de toute couverture sociale ou médicale. Généralement, ils passent leur temps au volant de leur voiture entre les universités X, Y et Z, à courir après les heures complémentaires. Ce statut peut durer une éternité, tant que l’adjunct n’arrive pas à obtenir un poste d’assistant avec tenure track. Mais, officier trois ou quatre ans comme adjunct, ce n’est vraiment pas la voie royale pour y parvenir. Et faire de la recherche dans ces conditions, c’est devenu très difficile. On tend donc à précariser les personnels. Dans les universités américaines, on ne compte globalement plus qu’environ 40% de personnels titulaires[5]...
Pour les étudiants, comment s’incarnent les différences entre le secteur privé et le secteur public ? Qu’en est-il des frais d’inscription des étudiants ?
Sur ce point, il faut bien entendu distinguer les universités publiques des universités privées. En ce qui concerne les universités privées, les frais d’inscription sont évidemment très élevés. À Yale ou Princeton, ces frais sont supérieurs aujourd’hui à 50 000 dollars par an, ce qui correspond à un endettement sur 4 ans de plus de 200 000 dollars, sans compter les frais annexes. J’ai des collègues universitaires issus de ces cursus qui remboursaient encore à 40 ans révolus les prêts qu’ils avaient contractés pour financer leur diplôme. Et plus inquiétant, les derniers chiffres montrent que, dans l’endettement des ménages américains, l’endettement lié aux études arrive tout juste derrière celui contracté pour l’achat d’un bien immobilier. Un seuil a sans doute été franchi.
Pour les universités publiques, il faut différencier les étudiants dont les parents résident et payent leurs impôts dans l’État de localisation de l’université (in state students), des autres, c’est-à-dire de ceux qui viennent d’un autre État (out of state students), ou d’un autre pays, étudiants internationaux. Pour les premiers, dans le cas de l’Université de Californie par exemple, les frais d’inscription s’élèvent aujourd’hui à un peu plus de 10000 dollars par an. Pour les autres, ceux qui viennent d’un autre État ou d’un autre pays, les montants sont proches de ceux observés dans le privé (36 000 dollars à UCSB, l’Université de Californie à Santa Barbara, publique, 48 000 à USC, l’Université de Californie du Sud, privée). Bien qu’il existe de nombreuses bourses attribuées au mérite ou en fonction des revenus, au final, beaucoup d’étudiants sont contraints de s’endetter (c’est le cas de 56% des undergraduates, étudiants de premier cycle de UCSB). Pour certains, issus de milieux sociaux plus favorisés, ou orientés vers des professions plus rentables, la dette sera absorbable. Pour les autres, elle ne le sera pas, ou difficilement. Pensez que le coût moyen d’une année à USC est, tous frais inclus, de 65 000 dollars, et multipliez par quatre... Je considère quant à moi cette situation intolérable dans une démocratie. Certains étudiants se mettent ainsi en péril et commencent leur vie avec des casseroles financières d’une lourdeur insupportable. C’est le cas aux États-Unis mais aussi en Angleterre, où les études sont devenues, de jour au lendemain, extrêmement onéreuses. Et nous devons lutter en Nouvelle Zélande contre l’augmentation constante des droits d’inscription, heureusement moins élevés, et la privatisation de fait des universités. Cela sera, dans les années à venir, un combat prioritaire partout dans ce monde universitaire globalisé, considéré de plus en plus comme un marché, tandis que les étudiants sont vus comme une clientèle.
Cette notion de clientèle a-t-elle un impact sur l’évaluation des travaux des étudiants ? Y a-t-il une pression sur la délivrance des diplômes ?
Je ne pense pas qu’il y ait encore d’effets majeurs. Ces étudiants s’attendent à ce que les exigences soient là. Ils savent que le sérieux du curriculum fait partie du prix qu’ils payent. C’est même une garantie pour eux de la rentabilité de leur « investissement ».
Si l’on veut structurer grossièrement le système universitaire américain, on peut dire qu’il y a trois grands pôles : les grandes universités (privées ou publiques), les universités moyennes d’État (ou leur équivalent privé) et enfin les community colleges, les établissements publics du supérieur rattachés à des métropoles.
À cela, il faut ajouter un nouveau phénomène qui est en pleine expansion, et qui participe à la construction du nouveau marché du supérieur : les établissements privés en ligne. Ce ne sont pas des universités, mais certaines comptent leurs étudiants par dizaines de milliers. Ainsi, The University of Phoenix, qui, contrairement à ce que son nom indique, n’est pas une université et n’est pas à Phoenix. Elles forment, entièrement en ligne, à des métiers comme celui d’infirmière, ou de géomètre et délivrent donc des diplômes professionnels. Ce sont des for profit organizations, à la différence des universités qui sont des non profit organizations, des établissements qui ne sont pas censés faire du profit. Frank Donoghue aborde le détail de ces nouveaux dispositifs dans l’ouvrage mentionné plus haut en note.[6]
Le paysage a ainsi été radicalement bouleversé en quelques décennies, mais aussi homogénéisé, au détriment des traditions et des spécificités nationales. Le fait d’avoir pas mal circulé m’a permis de voir l’accélération de ce mouvement. J’écris actuellement un ouvrage avec des collègues brésiliens. Nous travaillions dernièrement sur ce livre et nous discutions de leur université. Ils me disaient : « Ils n’ont plus qu’un mot à la bouche : impact ! » Et j’observe la même chose dans mon université. « Impact ! », c’est une préoccupation majeure de l’administration. Et en discutant avec des collègues ici, à la Sorbonne Nouvelle où j’ai enseigné dans les années 2000, je me suis rendu compte que la notion y était également d’actualité... Mais nous allons avoir l’occasion d’y revenir.
La notion d’impact nous amène à aborder un autre point important de l’entretien. Les scores de publication et autres impact factor sont directement connectés au développement d’une forme nouvelle d’évaluation des ensei-
gnants-chercheurs : une évaluation quantitative. Concrètement, les scores de publication régissent-ils les dérou- lements de carrière ? Les rémunéra- tions des chercheurs ?
L’impact de l’impact est réel sur les carrières. La philosophie générale est la suivante : tout doit être évalué, de haut en bas : les universités, les départements et, pour finir, les individus eux-mêmes. Pour les universités, nous avons le classement de l’université de Shanghai. C’est à la fois une conséquence et une condition de possibilité de la constitution d’un marché de l’enseignement supérieur globalisé. Mais ce n’est pas le seul système de classement. Son succès a été tel qu’il a fait école : il y a aussi dans le monde anglo-saxon le Times Higher Education Ranking et le QS World University Ranking. Pour certaines administrations universitaires, cela vire à l’obsession : sur la page d’accueil de mon université, on rappelle depuis maintenant trois mois que nous sommes quarantièmes en Humanités et Sciences Humaines dans le QS Ranking... C’est donc devenu un élément essentiel de la promotion des établissements sur le marché universitaire planétaire, comparable à celui des valeurs financières, qui a d’ailleurs fourni l’inspiration et le modèle. Mais cette logique, qui hiérarchise les établissements de l’enseignement supérieur dans le monde entier, s’applique également avec les mêmes critères aux départements à l’intérieur de chacun de ceux-ci, et, à l’intérieur des départements, aux individus, toujours selon le même type de critères.
Quels sont les critères mobilisés ?
On connaît les critères de classement des universités au plan mondial, publics mais pas dénués d’opacité. Il existe de même une hiérarchie de fait des départements dans une université comme la mienne : elle est basée sur le nombre d’étudiants, et tend donc à favoriser des formes de clientélisme. Elle est également fondée sur une mesure de la productivité de chaque composante en matière de recherche, basée quant à elle sur des critères de production individuelle sur lesquels je reviendrai. Il y a ainsi une hiérarchie et une compétition financière entre les départements, et donc le risque de voir disparaître des programmes négligés par les étudiants, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et quels que soient par ailleurs leur intérêt ou leur importance culturels. C’est une des difficultés à laquelle sont confrontés ceux qui enseignent les humanités.
Le second critère d’évaluation des départements, c’est donc le cumul des publications individuelles. Cela se traduit, pour les individus à l’intérieur de chaque département, pour les départements dans chaque université, et pour les universités elles-mêmes au plan mondial par une obsession de la visibilité[7], autre conséquence de la gestion néolibérale du monde universitaire comme marché global, qui passe par un côté publicitaire. Ainsi, il y a en ce moment même là où j’enseigne une vaste campagne interne qui vise à accroître « l’impact » de la recherche qui y est entreprise. Cette campagne ne se préoccupe pas d’améliorer la qualité éventuelle des publications, de consacrer plus de temps et de moyens à la recherche. Elle est exclusivement orientée vers la visibilité des travaux de chacun : on nous réunit pour nous expliquer que nos publications doivent être visibles pour accroître notre « impact », et que, pour qu’elles soient visibles, nous devons déposer en nombre sur le repository de la bibliothèque de l’université, site de libre accès où toutes les publications peuvent être consultées en ligne. Ce qui pose toute une série de problèmes : la confusion établie, tout d’abord, entre qualité et visibilité, selon le principe que ce qui ne se voit pas n’existe pas ; la croyance dans la mesure quantitative de la qualité, selon le principe de la conversion mécanique du nombre de publications mises en ligne en nombre de citations attendues de celles-ci ; le fait encore que cette foi dans l’évaluation quantitative mène à terme au dépérissement de l’exercice du jugement critique dans le débat d’idées. Lindsay Waters l’avait souligné dans son ouvrage : tout cela conduit au fait que dans les procédures d’évaluation scientifique, on lit et on discute de moins en moins les travaux des candidats à une promotion ou à une nomination, pour s’en remettre à une sorte de calcul des normes de productivité qui évacue ce qui devrait se trouver au centre des préoccupations d’institutions productrices de savoir, le débat d’idées.
J’ai quitté l’Université de Californie au début des années 2000 ; j’ai ensuite passé une dizaine d’années à la Sorbonne Nouvelle, puis enseigné depuis les années 2010 dans la zone Asie-Pacifique. Ce qui me frappe, c’est l’homogénéité, la rapidité et la brutalité des transformations qui conduisent aujourd’hui dans l’enseignement supérieur globalisé à évaluer en terme « d’impact » la qualité de la recherche universitaire. Ma conviction profonde est que cette évaluation avant tout quantitative – délaissant largement les nécessités d’une discussion approfondie de toute recherche, accélérant toujours plus les rythmes de production et de circulation de celle-ci, visant un effet immédiat de la réception du travail sans considération de la lenteur du temps nécessaire à son élaboration pas plus que de celui de sa diffusion – sapera inéluctablement les fondements mêmes de la recherche dans l’enseignement supérieur, en la dépouillant peu à peu de son bien le plus précieux : le temps. Celui de la pensée, celui de la réflexion.
Quelles sont les instances en charge de l’évaluation des enseignants- chercheurs ? Existe-t-il des institutions comme le CNU (Conseil National des Universités) en France qui statue sur la qualité scientifique des dossiers des candidats à une qualification, à une promotion ou à des CRCT ?
Aux États-Unis, il n’y a aucune instance d’évaluation nationale, hormis pour l’obtention de certaines bourses de recherche. Tout se passe au niveau local, au sein des établissements et des départements. On est évalué par ses collègues les plus proches, puis par une série de comités ad hoc, le dernier mot revenant généralement au doyen. L’avis initial, celui des « spécialistes », est souvent déterminant. Et c’est là que le bât blesse, quand on sait que la vie départementale est faite d’une longue histoire d’alliances et de discordes, de complicités et de détestations, au mieux d’indifférences, qui jouent bien évidemment leur rôle dans les procédures d’évaluation. Les choses se passent donc à peu près ainsi : le département se réunit en comité, afin d’évaluer le droit à l’avancement du professeur X. On énonce la règle du jeu : « Le professeur X est au rang Y, il gagne 90 000 dollars par an. Il peut être promu à 93 000 dollars ou avoir une promotion accélérée à 97 000. Mais il peut tout aussi bien stagner à son salaire actuel ». On présente alors le dossier du candidat, et on lit des lettres de recommandation de referees extérieurs au département. Suit une brève discussion, le plus souvent à mots couverts, au cours de laquelle je ne me souviens pas d’avoir jamais entendu véritablement discuter du fond de travaux que la plupart n’ont d’ailleurs pas lus. Suit un vote à bulletins secrets. Il arrive que les résultats soient équitables. Mais l’inconvénient de la procédure est évident : ses résultats sont parasités par la nature des relations interpersonnelles à l’intérieur des départements. Quand ceux-ci sont dysfonctionnels et l’ambiance délétère, les évaluations tournent volontiers aux règlements de compte, plus ou moins feutrés. J’ai toujours pensé que le genre littéraire américain des campus novels, ces romans du vase clos académique, trouvaient dans ce genre d’exercice une source inépuisable d’inspiration.
En Nouvelle Zélande, comme en Angleterre, la situation est différente : il y a une instance nationale d’évaluation. Cela s’appelle PBRF (Performance Based Research Funding) aux antipodes et REF (Research Excellence Framework) de l’autre côté de la Manche. Ces systèmes se ressemblent farouchement, selon une généalogie héritée, j’en ai bien peur, des anciennes administrations coloniales britanniques. Le principe est le même : une évaluation nationale de tous les enseignants chercheurs, qui couvre une période de 6 ans d’activité, au terme de laquelle chacun se voit attribuer une note personnelle, de A à C. La dotation globale des établissements en crédits publics de recherche en dépend. Dans ce type de système, les inconvénients sont autres : des procédures très lourdes, consommant un temps précieux (mon université commence ainsi à se préparer à la prochaine évaluation, qui aura lieu en... 2018), mobilisant des services administratifs entiers sur de longues périodes, mais aussi des procédures opaques et pratiquement sans appel pour des résultats souvent vécus comme injustes, voire punitifs par les chercheurs eux-mêmes. On y retrouve, par ailleurs, l’ensemble des problèmes posés par la mesure de « l’impact », car celle-ci est au cœur de la procédure de notation : une importance égale est attribuée à des modes de reconnaissance extérieurs à l’université (contributions to the research environment) et aux jugements des pairs (peer esteem) par un système qui privilégie par ailleurs les projets de recherche à la rentabilité courte et immédiate au détriment d’entreprises intellectuelles plus longues, plus audacieuses, mais plus incertaines.
Voilà ce qu’il me semble pouvoir dire de ce que j’ai pu observer ici et là. Je suis bien conscient du fait que ce sont surtout des inconvénients que j’y ai perçus. Peut- être tout simplement parce que, s’il y a bien une nécessité périodique de l’évaluation de la recherche et des enseignants chercheurs, l’application des logiques néolibérales aux métiers qui sont les nôtres se traduit de plus en plus par des pesanteurs et des contrôles renforcés, que ce soit, comme aux États-Unis, sous la forme de proximités normatives, ou, comme là où je me trouve à présent, sous celle de distances bureaucratiques. Il ne faut cependant pas cesser de le dire et le redire : ce dont la recherche universitaire a besoin avant tout, c’est de temps et de liberté d’entreprendre. Et de moins de contrôle, et de méfiance.
Je ne me prononcerai pas, pour finir, sur la question de savoir si les instances d’évaluation dont dispose l’université française, le traditionnel CNU ou la plus récente AERES, respectent ces nécessités fondamentales : je vous en laisse juges...
Quels sont les effets concrets, dans les universités, de ce classement national ?
Le salaire des enseignants n’est pas touché, mais l’université récolte moins de fonds publics de recherche pour un enseignant chercheur moins bien noté.
Il n’y a donc pas encore de conséquences sur les salaires des enseignants ?
Non, mais c’est probablement la prochaine étape. C’est dans la logique du système. Les universités ont d’autant plus d’argent de l’État qu’elles ont un nombre élevé de professeurs classés A. Elles exercent ainsi une pression constante sur les individus pour qu’ils rentrent dans cette catégorie, et notamment pour que leurs publications correspondent aux attentes du PBRF. La première conséquence en est le renforcement des exigences normatives quant à la conception et à la réalisation des projets de recherche eux-mêmes. Il s’agit d’aller au-devant des attentes normatives qui définissent ce qu’est un chercheur de type A, et ce que sont les « produits de recherche » (puisque c’est comme cela que l’on nomme à présent dans ces systèmes – research ouputs – ce que nous pensons et que nous écrivons) qui garantiront l’obtention des bonnes notes... La seconde conséquence, c’est que cette atmosphère de contrôle infantilisant n’est, bien évidemment, pas sans conséquence sur la vie psychique des individus eux- mêmes. Un de mes collègues s’est ainsi effondré lors du dernier exercice du PBRF : mauvaise note, dépression, arrêt de travail de longue maladie. Il n’y a pas à s’en étonner : le plus surprenant, c’est que cela ne se produise pas plus souvent. Car la morosité est générale. Mais il n’y a là rien d’autre à signaler que le fonctionnement ordinaire d’une institution sous influence néolibérale. Avec un effet secondaire, cependant, qui doit être souligné : personne ne parle plus de cet « accident du travail », devenu une sorte de tabou. Ce silence en dit long...
On a vraiment l’impression d’une défiance à l’égard des enseignants- chercheurs... La libido sciendi ne semble pas pouvoir exister dans ce système qui cherche à tout contrôler et mesurer... Comme si, sans ces dispositifs, les chercheurs risquaient de ne plus travailler...
C’est en effet une culture de la méfiance. Ainsi, je ne peux pas rentrer moi-même dans l’architecture de mon CV tel qu’il est utilisé par l’université. Je ne peux pas entrer mes publications sur ma page web, mon rapport de recherche annuel, ou encore mon dossier pour le PBRF. C’est un service spécialisé de la bibliothèque qui s’en charge, va les chercher sur internet, et qui les y rentre. Vous avez donc raison à propos de la défiance. Mais il faut inverser la proposition que vous venez de formuler : ces dispositifs sont précisément conçus pour empêcher les chercheurs de travailler, les empêcher de travailler d’une certaine manière, pour privilégier la productivité au détriment de la créativité.
Est-ce que des mouvements comme celui de la « Désexcellence »[8] en Belgique existent dans ces universités ? Tout ce qui s’incarne dans la Slow Science...
J’ai bien peur que non. Ce que je constate autour de moi, c’est essentiellement de la lassitude, une certaine résignation, ponctuée de refus syndicaux sporadiques.
Est-ce que c’est la précarité de position des gens qui explique ça ?
Non, ceux dont je vous parle sont pour la plupart titulaires. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a, là où j’enseigne, une forme d’acquiescement collectif à ce type de management des universités. C’est bien là le problème : le sentiment qu’il n’y aurait pas d’autre voie, pas de possibilité de refus collectif, ou bien qu’il y aura toujours moyen de tirer individuellement bénéfice du système...
Nous avons l’impression que les transformations de l’enseignement supérieur et de recherche en France produisent des configurations paradoxales qui entravent les résistances. D’un côté, les universités en faillite se multiplient : il faut réduire les offres de formation, la précarisation des personnels se renforce... Mais de l’autre, certains pôles (et donc certains universitaires) héritent de mannes de financement colossales à travers les LABEX, IDEX et autres contrats
européens... Pour certains, ces transformations apportent donc un plus non négligeable, et ceux qui n’y ont pas accès multiplient les efforts pour « en être » ! Chacun espère tirer son épingle du jeu...
Je ne vois rien dans la situation que vous décrivez qui vienne contredire ce que j’observe là où je travaille. L’introduction de ces politiques de gestion néolibérale à l’université n’a fait qu’intensifier des formes de concurrence et de compétition entre les individus qui se sont détachées des modèles plus anciens d’émulation et d’excellence, tels qu’ils étaient promus, en France par exemple, par les valeurs traditionnelles de l’école républicaine. Les profits ont cessé d’être essentiellement symboliques, ils sont désormais chiffrés, comme toute valeur d’une économie de marché gagnant progressivement tous les secteurs de la société, y compris, bien sûr, celui de la production des connaissances. Et là comme ailleurs, la distribution inégale des profits est la règle. C’est ainsi qu’un plus pour un petit nombre est aussi clairement un rien pour la plupart.
Mais, à bien y regarder, ce système ne tient pas ses promesses. Une infime minorité des projets sont retenus (que ce soit dans le cadre des ANR, des contrats européens ou des contrats postdoctoraux). Et, au final, nous passons notre temps à rédiger des projets ou à en évaluer, tout cela sur un temps de travail non rémunéré... Ce système d’évaluation et de mise en concurrence repose pour beaucoup sur du bénévolat et ses retombées restent très localisées. Peut-être qu’une forme de résistance peut se nicher là-dedans, si les « ouvriers » du système s’arrêtent et cessent de l’alimenter ?
Vous avez raison. La défense du temps est très importante. La défense du temps individuel et du fait qu’on a besoin de temps, que ce temps est précieux, et qu’il doit être consacré à l’activité de penser elle-même, plutôt qu’à l’économie parasite, périphérique, qui aujourd’hui l’étouffe. Oui, il faut pouvoir errer, hésiter, se tromper. Il y a un temps nécessaire à l’élaboration de la pensée. La pensée se développe aussi dans la durée, de façon non linéaire, elle a besoin de « temps morts », dont on sait bien qu’ils sont tout, ces temps-là, sauf « morts », justement. Je pense également à autre chose. J’ai lu dernièrement le livre de Jonathan Crary 24/7[9], sur le capitalisme et la fin du sommeil. Il montre que c’est la dernière frontière, ce à quoi on s’attaque à présent. Il donne à voir de façon très convaincant combien la question du temps – et en particulier des temps « morts » du repos et du sommeil – constitue pour les politiques néolibérales le dernier bastion à conquérir. Du coup, cela indique aussi le terrain sur lequel la résistance est possible : celui du temps, de sa réappropriation, du refus de cette exigence de disponibilité continue qu’on nous impose, de cette mise à disposition permanente qu’on nous réclame. C’est là précisément le contraire de ces politiques de l’accélération, de l’urgence, de la multiplication des tâches et de la productivité : à l’opposé de « l’impact de l’impact », laisser du temps au temps, du temps pour tous...
Notes
[1] Lindsay Waters, L’éclipse du savoir, Paris, Editions Allia, 2008. Traduction française de l’ouvrage de Lindsay Waters, Ennemies of Promise. Publishing, perishing, and the Eclipse of Scholarship, Prickly Paradigm Press LLC, Illinois, USA, 2004.
[2] Voir plus loin.
[3] Voir Jean-Jacques Courtine & Claudine Haroche, « Campus américains : le français en
déclin », Le Monde, 1er novembre 2010
[4] [NDLR] Dont la fameuse « Ivy league » qui ne retient que les 8 établissements les plus prestigieux des USA et qui semble souvent prise en France comme modèle de référence sans aucun recul critique.
[5] On trouvera dans le livre de Frank Donoghue (The Last Professors : The Corporate University and the Fate of the Humanities, Fordham University Press, 2008) des éléments chiffrés sur cet ensemble de points.
[6] Frank Donoghue, op. cit.
[7] Voir Claudine Haroche, « L’invisibilité interdite », in Les tyrannies de la visibilité. Etre
visible pour exister, Paris, Erès, 2011.
[8] Voir http://lac.ulb.ac.be/LAC/home.html
[9] Jonathan Crary, 24/7. Late Capitalism & the End of Sleep, London/New York, Verso, 2013.
Les observations et réflexions critiques de Jean-Jacques Courtine sur le système universitaire nord-américain et sur les évolutions du système universitaire français, récoltées au cours d’un entretien réflexif mené par Christel Coton et Romain Pudal, rejoignent les préoccupations de l’ASES. Pour prolonger ces analyses, en lien avec la situation française de l’enseignement supérieur et de la recherche, nous vous signalons quelques autres ressources, que nous avons proposées ou remarquées.
Sur l’évaluation en France, notre bulletin n°40 « Lost in Evaluation » (coordonné par Fanny Jedlicki), avec les contributions de Christian Topalov, David Pontille & Didier Torny, Gérard Rimbert et Valérie Boussard.
Sur les effets potentiellement délétères d’une évaluation systématique et récurrente des enseignants-chercheurs dans le cadre austéritaire actuel, voir notre demande argumentée d’abrogation du décret de 2009.
Pour une réflexion sur le processus de transformation néolibérale des universités françaises, voir l’article de Matthieu Hély, dans la revue Contretemps : « Pour l’autogouvernement des universitaires comme résistance à la rationalisation néolibérale de l’enseignement supérieur public ».
Sur les transformations des universités françaises, sous l’effet de la LRU et de la « loi Fioraso » de 2013, voir également le compte rendu d’une journée de réflexion organisée en octobre 2013 : « Les comptes des universités : les conditions de travail des personnels et les risques pour l’enseignement supérieur et la recherche ».
Voir aussi sur le même sujet, l’article d’Odile Henry et Jérémy Sinigiglia (publié également sur le site Terrains de Lutte) « Contraintes budgétaires et stratégies gestionnaires des universités », dans le numéro de la revue Savoir/Agir n°29 (automne 2014), dont nous vous recommandons fortement la lecture (pour commander le numéro, c’est ici).
Enfin sur les frais d’inscription à l’université, signalons la parution récente d’un ouvrage, à la lecture très stimulante, du collectif ACIDES, Arrêtons les frais ! Pour un enseignement supérieur gratuit et émancipateur, Paris, Raisons d’agir, 2015.