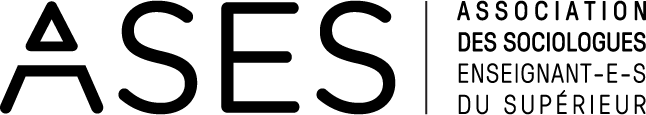Parcoursup : Hayek chez Orwell, par Christian de Montlibert
Avec, en 1998, la mise en place du « processus de Bologne » qui transforme les curricula disciplinaires en parcours d’accumulation de points (ECTS), puis la « loi de programmation de la recherche » de 2006 qui impose le regroupement de laboratoires et d’universités, crée une Agence d’évaluation et permet le développement de fondations pour drainer des fonds, la « loi LRU » de 2007, ensuite, qui donne des pouvoirs accrus au président de l’université, (dont des capacités de recrutement et de répartition des primes) et permet une réduction du contrôle des pairs sur les carrières, puis la loi de 2010 qui préconise l’Université Numérique, qui transforme les premiers cycles en cycle pluri-disciplinaires d’élaboration de « projets » individuels et qui offre aux établissements privés la possibilité d’une légitimation d’Etat, l’avancement de l’enseignement supérieur, vers son avenir néolibéral tel que l’ont imaginé l’OCDE, la Banque mondiale, le patronat européen rassemblé dans l’European Round Table, la Commission européenne, et les chefs d’Etat réunis à Lisbonne autour de « l‘économie de la connaissance » se poursuit inexorablement. Parcours sup est un pas de plus dans cette transformation en imposant une logique d’ajustement de l’offre et de la demande, une objectivation de la formation du prix de chaque élève, et un marchélibre et non faussépour assurer la répartition des lycéens dans l’enseignement supérieur.
Les lycéens, lycéennes sont d’abord des demandeurs. La formation de leur prix s’inspire pour beaucoup des démarches d’embauche. Leur valeur est, en effet, déterminée par leurs compétences (leur degré d’autonomie, leur méthode de travail, leur esprit d’initiative et leur capacité a s’investir), en second parleurs connaissances ( les notes, pondérées par le rang de classement de l’établissement), en troisième lieu par leurs motivations ( les apprentissages et expériences extrascolaires, ce qui prend en compte les investissements des familles), et enfin par leurs prétentions c’est à dire , ici, le type de formation postulée. Chacun devient un entrepreneur de soi, responsable de ses réussites et de ses échecs, maitre de son « projet », en lutte contre tous, pour occuper une place. Parcours supen engendrant, ouvertement, un monde de concurrence oblige familles et élèves à apprendre à « se vendre ». De Leroy-Beaulieu à Friedrich August Hayek on peut triompher ! Cette demande est ajustée à une offredéfinie par le nombre de places, parles compétences exigéespar la discipline (telles que les définit le Répertoire national des certifications professionnelles, RNCP), et, surtout, par les stratégies de recrutement élaborées par l’établissement. C’est dire que l’offre dépend du marché d’établissements universitaires en concurrence les uns avec les autres (privés/publics, écoles/universités, université/université…). Le rêve « d’un entrepreneuriat universitaire, défendu au cours du Conseil européen de Lisbonne, progresse.
Mais la concurrence n’est pas pure et parfaite ; elle est faussée par des « facteurs sociaux». La hiérarchie des établissements, où critères scolaires et critères sociaux se mêlent, en est le premier. Dans ces conditions, tout se passe comme si les « meilleurs » sélectionnaient les étudiants-étudiantes qui avaient la « valeur » maximale, renvoyant les autres vers des établissements de second rang qui, à leur tour, pratiquaient, après avoir opéré leur sélection, le renvoi des dossiers restants vers des établissements de troisième rang, et ainsi de suite.
L’enseignement supérieur est, il est vrai, une institution qui contribue à une « reproduction» de la hiérarchie sociale. Les politiques d’élévation des niveaux d’études de ces dernières décades, ont certes permis l’accès à l’enseignement supérieur d’un plus grand nombre d’enfants mais les écarts entre classes sociales n’ont guère bougé. Reste qu’avec la massification, (manière avantageuse de diminuer le chômage des jeunes), l’illusion d’une démocratisation s’est installée, élargissant en somme l’horizon social des classes intermédiaires et populaires, tout en les soumettant plus encore à une domination du système scolaire. Avec Parcours sup, cette illusion change de nature. Le tour de magie sociale – très efficace puisqu’il dissimulait la réalité – est confié à des algorithmes. La « violence symbolique » passe du verbe à la rationalité du calcul.
La décision finale devient unverdict qui, s’il consacre positivement, consacre aussi négativement,et même stigmatise : se voir retenu dans une « bonne » formation confirme aux yeux de tous les dons du candidat, ne recevoir aucune orientation ou être très bas sur les listes d’attente, c’est comprendre qu’on est « bon à rien » et qu’ il ne reste qu’à « aller voir ailleurs ». Le sentiment d’incompétence est en quelque sorte validé et justifie l’auto-exclusion, ce que font tous ceux qui retirent leur dossier (au 11 juin, 44 689 élèves avaient quitté le processus). Dans cet univers hayekien, les aspirations irréalistes ou fantaisistes n’ont, bien entendu, pas de place : les élèves doivent apprendre à ajuster leurs espérances subjectives à leurs chances objectives et il leur faut souvent « en rabattre », ce qui élimine des décalages ou des désajustements perturbateurs de l’ordre social, (seuls O, 91% des lycéens, au 11 juin, contestent la décision).
Le second « facteur social » qui fausse la concurrence relève de la structure sociale. De fait Parcours sup réalise le vœu secret des classes moyennes et supérieures ; l’expansion scolaire s’est réalisée au grand regret des familles des classes dominantes persuadées que cette augmentation risque de dévaluer la valeur des diplômes et de diminuer mécaniquement les chances de leur progéniture. Dans ces conditions de concurrence accrue, la logique de parcours supqui écarte « les maillons faibles » n’est pas pour déplaire à ces classes sociales qui sont surreprésentées chez les élus de la République en marche et dans l’électorat de Macron. Avec Parcours sup« l’appropriation différentielle des biens scolaires » devrait, une fois corrigées les erreurs et maladresses repérées aujourd’hui, fonctionner au mieux.
Enfin avantage supplémentaire, ce système répond aux souhaits de la Banque mondiale qui, dès 1994, effrayée par la hausse des coûts entrainés par l’accroissement du nombre d’étudiantes et d’étudiants, réclamait la mise en place d’organisations « moins couteuses » grâce à des « institutions diversifiées en fonction de la demande ».
A lire en ligne ici