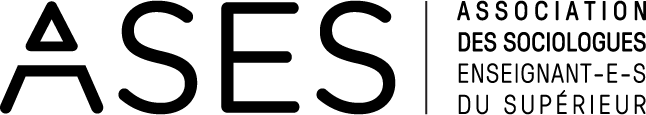Qui protège les chercheurs de la surveillance de l’Etat ?
Par Marwan Mohammed, Sociologue au CNRS, Centre Maurice-Halbwachs. — 8 novembre 2015 à 18:56
En facilitant les écoutes, la loi renseignement promulguée en juillet menace le travail des chercheurs en sciences sociales et la confidentialité de leurs sources. La possibilité de mieux connaître des sujets sensibles comme la radicalisation ou la criminalité organisée est en jeu.
Qui protège les chercheurs de la surveillance de l’Etat ?
La loi relative au renseignement promulguée le 24 juillet 2015 marque une rupture importante en autorisant différents services de renseignement à opérer une surveillance de masse et de plus en plus intrusive. Cette loi vise notamment à prévenir le terrorisme, mais également à lutter contre «la criminalité et la délinquance organisée», contre ce qui menace «la forme républicaine des institutions» ainsi que les «violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique». Au-delà de ces motifs volontairement vagues, c’est tout un appareillage technique qui permet d’espionner un suspect en localisant son téléphone et son ordinateur, en prenant connaissance de ses différentes communications numériques ou de sonoriser son domicile et son véhicule. La surveillance ne concerne pas que le suspect, son entourage donc toute personne en contact avec lui peut faire l’objet des mêmes mesures. Une autorité de contrôle est prévue, placée sous la responsabilité du Premier ministre. Mais selon de très nombreuses organisations et des juristes, elle n’apporte pas les garanties nécessaires, les mécanismes de contrôle tout comme l’indépendance essentielle à une telle mission sont insuffisants. Plusieurs institutions ne sont théoriquement pas concernées. Un statut particulier est accordé aux journalistes, aux avocats, aux magistrats ainsi qu’aux parlementaires, mais seulement dans l’exercice de leurs fonctions et non dans le cadre privé. La nature professionnelle ou privée n’étant établie qu’après traitement des données… Insuffisant pour une partie de leurs représentants comme l’Association de la presse judiciaire (APJ) qui a décidé de saisir la justice européenne pour protester contre l’insuffisance des protections juridiques concernant la confidentialité des informations et des sources. Plusieurs corps du secteur médico-social se sont par ailleurs émus de la remise en question du secret professionnel ou du secret médical. A l’inverse, les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur se sont peu manifestés.
Cette loi impacte directement le travail des chercheurs en sciences humaines et sociales, particulièrement les recherches de type ethnographique sur des sujets «chauds», jugés sensibles. Elle menace plus spécifiquement ceux, dont je fais partie, qui s’intéressent à des thèmes et des personnes potentiellement visées par la loi en question. Car toute recherche qui touche la criminalité, qu’elle soit «ordinaire» ou organisée, les mouvements syndicaux, politiques et religieux, les différentes formes de radicalité militante, voire des domaines économiques, administratifs ou militaires considérés comme stratégiques, est susceptible d’entraîner une intrusion par les services. Ce qui fait beaucoup.
Au-delà de cette loi, c’est la possibilité de produire des connaissances nouvelles en apportant des garanties aux personnes interrogées qui est en jeu. Les droits du chercheur et de «l’enquêté» sont liés dans les avancées scientifiques et donc les progrès théoriques en sciences humaines et sociales. C’est dans ce sens que l’Association française de sociologie a apporté son soutien à Antoine Deltour, lanceur d’alerte de l’affaire LuxLeaks. Ce dernier ne participe pas seulement à éclairer l’opinion et les pouvoirs publics sur les dérives de la finance. Il incarne un type d’acteur nécessaire au développement de la sociologie, des sciences politiques ou de l’ethnologie, permettant une meilleure connaissance de nos sociétés.
Il y a cinq ans, Sylvain Laurens et Frédéric Neyrat dirigeaient un ouvrage sur les conditions éthiques et juridiques de la recherche (1). Ils alertaient notamment sur la multiplication de contentieux et de pressions visant les chercheurs, leurs données mais également leurs sources. Proposant une analogie avec le travail journalistique (d’enquête), ils posaient déjà la question, après d’autres, du rapport entre la confiance donnée au chercheur, l’anonymat et la protection par le droit de cette relation. D’autant que la recherche de type ethnographique s’inscrit dans le temps long. Et ce n’est pas une inquiétude abstraite. Sans faire références à la pluralité des situations à l’étranger, qui sait que Thierry Dominici, alors doctorant à l’université de Bordeaux, a vu en 2010 toutes ses données d’enquête saisies à son domicile par la Direction nationale antiterroriste (DNAT) sur ordre d’une juge d’instruction ? Il dut rédiger sa thèse «de mémoire» sans pouvoir jamais obtenir restitution ou copie de ses propres données. Son sujet ? Les mouvements nationalistes corses.
La mise en sécurité physique et informatique des données recueillies, si tant est qu’elle soit complètement possible, aurait été une mesure de prudence nécessaire mais possiblement insuffisante. Rappelons-nous que notre collègue Pinar Selek, sociologue arrêtée en 1998 par les autorités turques, fut emprisonnée et torturée car elle refusait de fournir les noms et les informations sur les militants kurdes qu’elle étudiait. Le fait qu’elle mette ses données en lieu sûr ne lui a pas évité les déboires que l’on connaît. Certes, aucun chercheur français n’a été torturé mais qu’est-ce qui empêche l’autorité judiciaire d’exiger des données privées d’un individu, qu’est ce qui protège les chercheurs d’une intrusion policière directe ou à distance (par la prise de contrôle des données informatiques) ?
J’ai pour ma part renoncé très récemment à un projet de recherche qui devait porter sur l’expérience sociale de la «radicalisation» violente malgré de belles perspectives empiriques. Il m’était impossible, en toute honnêteté, d’apporter toutes les garanties nécessaires aux enquêtés, même si toutes les précautions étaient prises. Car l’enquête nous engage personnellement - notre éthique et notre sécurité sont en jeu - et pas seulement notre fonction ou notre institution. Dans la foulée des tueries de janvier dernier, le CNRS a émis l’intention de participer à l’effort de connaissance nécessaire et encore insuffisant sur les radicalismes violents. L’intention et la mise à disposition de moyens de recherche sont louables, pensons désormais aux conditions juridiques de leur réalisation.
(1) «Enquêter : de quels droits ?, menaces sur l’enquête en sciences sociales», Paris, Editions du croquant, 2010
Marwan Mohammed Sociologue au CNRS, Centre Maurice-Halbwachs.